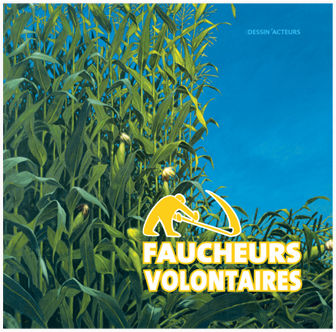La lutte des faucheur·ses d’OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) est l’une des plus emblématiques de la désobéissance civile (1) en France. Iels agissent à visage découvert de manière non violente, revendiquent leurs actes et vont jusqu’à exiger de comparaître volontairement devant les tribunaux. Iels ont permis au débat sur les OGM d’émerger dans la sphère publique. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui ont choisi l’illégalité pour défendre leur cause ? Iels témoignent d’une manière originale dans un livre mêlant récits, interviews, comptes-rendus d’audiences, bandes dessinées, photos...
C’est en 1996, au sein de la Confédération paysanne, que le combat contre les OGM débute en France. Le premier arrachage a lieu en Rhône-Alpes, le 7 juin 1997. Il s’agit de colza transgénique. Depuis, la lutte n’a pas faibli, dépassant les frontières du syndicat pour être porté par un mouvement indépendant : Les Faucheurs Volontaires.
Le livre s’ouvre sur des extraits de la charte des Faucheurs Volontaires. Elle rappelle qu’ils « ne s’attaquent pas à la recherche fondamentale ». « A leurs yeux, celle-ci doit suivre des protocoles rigoureux dans des expériences en milieu confiné (…). Ce que dénoncent les Faucheurs Volontaires, ce sont les expérimentations et les cultures en plein champ qui permettent la contamination irréversible des autres espèces végétales. (…) Ce qu’ils dénoncent, c’est le brevetage du vivant qui mettra les paysans du Nord comme du Sud sous l’emprise de la domination des entreprises biotechnologiques (…). Ils dénoncent aussi l’abandon du consommateur à une politique de distribution alimentaire oublieuse du principe de précaution sans se soucier des conséquences sanitaires (…). »
Les pages laissent ensuite la parole à Kévin (24 ans, bûcheron), Sylvie (47 ans, infirmière à domicile), Raymond (58 ans, paysan), Chantal (53 ans, agriCultrice – elle tient au C majuscule), Olivier (42 ans, animateur dans une coopérative associative), Marie-Edith (56 ans, assistante maternelle), Alain (64 ans, instituteur spécialisé à la retraite), Virginie (35 ans, comédienne). A travers des entretiens, iels racontent pourquoi iels sont entré·es dans le mouvement et comment iels y contribuent. Iels parlent de la force du collectif et de la joie d’agir ensemble. Iels parlent aussi de leurs peurs, de leurs doutes et des instants de découragement. Malgré tout – les perquisitions, les arrestations, les condamnations – iels assument leurs actes et affirment leur certitude d’agir pour le bien commun.
A chaque grande étape de la lutte, une double page illustrée et ponctuée de citations d’autres faucheur·ses rappelle la progression du mouvement. Des « figures » s’expriment aussi, comme Jean-Baptiste Libouban (l’un des initiateurs du mouvement), José Bové (longtemps porte-parole de la Confédération paysanne puis député européen), Marie-Christine Etelin (avocate, spécialiste en droit pénal et rural) ou encore Christian Vélot (docteur en biologie et lanceur d’alerte). Tous·tes ont contribué à faire avancer la réflexion au sein de la société civile mais aussi au niveau législatif.
Un texte m’a profondément émue et résonne particulièrement avec l’actualité militante : intitulé « La nuit auprès d’un maïs, le cœur bat plus fort... », signé Thierry Dominique, il est mis en page sous forme de courte nouvelle illustrée. Il raconte un fauchage de nuit à travers les réflexions intérieures d’un militant en proie à la peur malgré sa détermination : « Pourquoi l’Etat écoute-t-il plus facilement les lobbys semenciers que les citoyens ? Pourquoi l’Etat cède-t-il si facilement à la pression de ce petit groupuscule mafieux alors que nous représentons le plus grand nombre ? (2) Les raisons, je les connais mais je ne veux pas les accepter, je ne le peux pas. Pas sans rien dire. Pas sans rien faire. Il faut que j’occupe ma place, seulement ma place. Mais toute ma place. »
Le livre « Faucheurs Volontaires » a été réalisé et publié par l’association les Dessin’acteurs en 2010. Celle-ci réunit des créateur·ices, des acteur·ices de l’édition et des citoyen·nes qui mettent en commun leurs compétences pour des actions humanitaires, environnementales, sociétales… notamment à travers l’illustration et la bande dessinée.
F.L.
(1) John Rawls, cité dans le livre, en donne la définition suivante : « La désobéissance civile peut être définie comme un acte non-violent décidé en conscience, mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi, ou bien, dans la politique du gouvernement. La loi est enfreinte mais la fidélité à la loi est exprimée par la nature publique et non violente de l’acte. »
(2) En 2004, un sondage réalisé par « 60 millions de consommateurs » montre que 80 % des Français·es pensent que les agriculteur·ices ne doivent pas cultiver d’OGM.