Dimanche 11 mars 2018 – 16 heures – place de la République à Paris.
Un petit drapeau jaune, avec le symbole de la radioactivité barré de rouge. Il ne flotte plus au vent, il gît à terre. Ceux et celles qui l'aperçoivent en marchant le contournent. Est-ce qu'il les indiffère ? Ou n'est-ce simplement pas encore le moment ? Cette image s'installera-t-elle durablement en eux, en elles, et un jour, se rappellera à leur souvenir, les réveillera pour les émouvoir, les raisonner ?
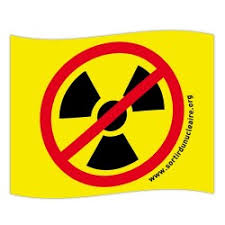 Je me baisse pour le ramasser et le faire se tenir debout. Non, l'anti-nucléaire n'est pas mort. A quelques mètres de moi, des dizaines, des centaines de militants venus commémorer la catastrophe de Fukushima (*), et affirmer leur volonté de vivre dans un monde où l'énergie est produite et utilisée de manière sûre, sans conséquences irréversibles sur les êtres vivants et leur environnement. Le nucléaire est tout le contraire.
Je me baisse pour le ramasser et le faire se tenir debout. Non, l'anti-nucléaire n'est pas mort. A quelques mètres de moi, des dizaines, des centaines de militants venus commémorer la catastrophe de Fukushima (*), et affirmer leur volonté de vivre dans un monde où l'énergie est produite et utilisée de manière sûre, sans conséquences irréversibles sur les êtres vivants et leur environnement. Le nucléaire est tout le contraire.
Le rassemblement se déroule sous un soleil anormalement chaud pour cette saison et l'air que je respire m'agresse les bronches. Je cherche du regard les amis berrichons : une quinzaine d'entre eux sont là, notamment des membres de l'association « Sortir Du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye » et du comité local pour le soutien à Bure.
Je réfléchis. Quand le symbole de la radioactivité barré de rouge s'est ancré en moi ? C'était au collège, donc dans les années 1995. En cours d'Histoire. Je ne crois pas que le nucléaire ait été au programme mais Jacques Chirac, fraîchement élu président de la République, venait de reprendre les essais dans le Pacifique. Sans doute l'enseignante répondait-elle aux questions de ses élèves sur le sujet. Toujours est-il que je me souviens nettement de la Une du journal Libération daté du 12 mai 1986 qu'elle projeta contre le mur blanc de la classe : « Le mensonge radioactif – Le nuage radioactif de Tchernobyl a bien survolé une partie de l'Hexagone ». Puis le document de l'IRSN (**), sorte de scanner rouge, orange et jaune sur fond noir, daté du 1er mai 1986, corroborant les affirmations des journalistes.
Au lycée, une autre enseignante, de physique-chimie cette fois, me raconta l'expérience qu'elle fît sur les salades de son potager durant les jours qui suivirent la catastrophe en Ukraine. Les résultats étaient terrifiants...
 Quinze années ont passé avant que j'entende parler de la centrale de Brennilis (à l'arrêt depuis 1985 et toujours pas démantelée) alors que je vivais en Bretagne à 200 kilomètres à peine… Presque dix ans de plus pour arriver à Sancerre et découvrir, en même temps que la superbe vue des hauteurs du Piton, la centrale de Belleville-sur-Loire… La chance de pouvoir y pénétrer, de visiter son coeur ; d'échanger avec ses défenseurs, de rencontrer ses opposants ; de cotoyer des membres du personnel, des habitants de la zone, des élus dont les communes profitent de la manne financière… De comprendre, finalement, que le système est avant tout économique et politique. Et donc réversible à condition de volonté.
Quinze années ont passé avant que j'entende parler de la centrale de Brennilis (à l'arrêt depuis 1985 et toujours pas démantelée) alors que je vivais en Bretagne à 200 kilomètres à peine… Presque dix ans de plus pour arriver à Sancerre et découvrir, en même temps que la superbe vue des hauteurs du Piton, la centrale de Belleville-sur-Loire… La chance de pouvoir y pénétrer, de visiter son coeur ; d'échanger avec ses défenseurs, de rencontrer ses opposants ; de cotoyer des membres du personnel, des habitants de la zone, des élus dont les communes profitent de la manne financière… De comprendre, finalement, que le système est avant tout économique et politique. Et donc réversible à condition de volonté.
Celle des anti-nucléaires est intacte. Certes, ils ne sont pas majoritaires dans la population. Mais le réseau est de mieux en mieux organisé et, avec Bure, on reconnaît dans les deux camps être arrivés à un tournant de la lutte. Un petit souffle ne vient-il pas de soulever mon drapeau ?
____________________________________________
Un réseau unique au monde
____________________________________________
Lundi 5 mars 2018 – 15 heures – Bannay
Françoise Pouzet, présidente de Sortir Du Nucléaire (SDN) Berry-Giennois-Puisaye explore aussi sa mémoire, pour retrouver quand, avec Lucien Petit, elle a créé le Comité Stop Belleville – Stop Dampierre. En 1999. « C'était suite à l'annonce des problèmes de porosité de l'enceinte de confinement de la centrale de Belleville, raconte-t-elle. Notre but était d'informer la population, de la mobiliser pour faire fermer définitivement la centrale. Elle est restée un moment sans fonctionner. Puis, une nouvelle couche de polymer a été appliquée pour colmater et elle a redémarré. » A l'époque, la première réunion avait attiré de nombreux habitants du Cher mais aussi du Loiret concernés par la centrale située à Dampierre-en-Burly : « On avait rempli la maison ! » Ils ont organisé des manifestations, des marches, des chaînes humaines, tenté de sensibiliser les médias locaux à leur cause… Mais progressivement, d'année en année, face au puissant ennemi, le découragement s'est installé, les rangs des militants se sont éclaircis. « Tchernobyl s'éloignait… Et puis, malgré les preuves du danger, malgré tout ce que nous faisions, la centrale fonctionnait toujours... »
Il faudra une nouvelle catastrophe pour réveiller les consciences. « Tchernobyl, c'était l'URSS ; pour beaucoup, ce n'était pas vraiment surprenant que ça arrive là-bas… Mais Fukushima a eu une autre portée : le Japon est une société développée, proche de la nôtre. Et les gens ont compris que c'était grave, très grave. » Le 11 mars 2011, elle apprend la nouvelle à la radio. « Avec un ami, on s'est dit : mais qu'est-ce qu'on fait là ? On ne peut pas rester sans rien faire ! Alors, on est descendu dans la rue, à Cosne ! Et tous les mardis pendant un an, puis une fois par mois jusqu'aux élections présidentielles et législatives, nous avons manifesté. »
 Le Comité Stop Belleville – Stop Dampierre devient Sortir Du Nucléaire Berry-Puisaye et rejoint le réseau national. Deux ans plus tard, le Giennois est intégré.
Le Comité Stop Belleville – Stop Dampierre devient Sortir Du Nucléaire Berry-Puisaye et rejoint le réseau national. Deux ans plus tard, le Giennois est intégré.
Le réseau Sortir Du Nucléaire (SDN) est unique au monde. Il a été créé en 1997 suite à la victoire de l'arrêt du surgénérateur Superphénix en Isère (lire aussi (Re)découvrir). Aujourd'hui, on compte 60.000 signataires et 930 associations à ratifier sa charte d'objectifs.
Son rôle n'est pas seulement de dénoncer les mauvaises pratiques de la filière nucléaire, mais aussi de proposer des solutions alternatives. Par exemple : favoriser les économies d'énergie et l'efficacité énergétique ; mettre en place une politique basée sur les énergies renouvelables ; en phase transitoire, recourir à des techniques de production énergétiques les moins néfastes possibles pour l'environnement (comme les centrales au gaz ou de cogénération)…
« Le réseau s'est doté de conseillers juridiques et d'avocats pour mener des actions en justice », précise Françoise Pouzet. Il peut ainsi soutenir des initiatives locales et régionales : comme dans le Centre, la plainte déposée contre EDF pour une série de négligences graves relevées sur le site de la centrale de Chinon. Au niveau de la communication, faire partie du réseau est également une aide : « Nos actions au niveau local sont relayées sur le site Internet national et vice-versa. »
Pour informer la population comme pour alerter les institutions, un important travail de veille est assuré par les bénévoles : veille technique sur le développement de la filière ; veille politique sur les projets de loi ; veille juridique pour connaître les jurisprudences des procès ; veille environnementale pour évaluer les conséquences du nucléaire sur les écosystèmes... « C'est un domaine où il faut aimer lire pour comprendre, parce que c'est à la fois technique et politique », reconnaît Françoise Pouzet. Dernièrement, elle s'est penchée sur le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) qui concerne la zone de la centrale de Belleville-sur-Loire proche de la Loire. Une enquête publique était ouverte, à laquelle elle a contribué en notant ses remarques dans le registre et en discutant avec le commissaire-enquêteur. « En cas de crue importante, la centrale serait complètement encerclée par les eaux. Ce qui excluerait toute possibilité d'interventions en cas de problème à l'intérieur… Ou alors en barque... »
_________________________________________________________________
Une commission locale de désinformation ?
_________________________________________________________________
La CLI (Commission Locale d'Information) devrait être une source intéressante. « C'est plutôt la commission de désinformation », ironise Françoise Pouzet.
Créée en 1983 suite à la circulaire Mauroy par Jean-François Deniau, alors président du Conseil général du Cher, elle a pour missions d'informer la population sur le fonctionnement de la centrale et sur le suivi de son impact sur l'environnement. Les réunions, organisées deux à trois fois par an, traitent ainsi des questions techniques relatives au fonctionnement de la centrale, des analyses des incidents et des nouveaux équipements.
Ses membres sont des élus, des représentants d'associations de protection de l'environnement, d'organisations syndicales des salariés, du monde économique, d'ordres professionnels liés à la santé ou encore des personnes désignées pour leurs compétences dans les domaines de la sécurité nucléaire ou de la communication.
Elle est actuellement présidée par Patrick Bagot, maire de Belleville-sur-Loire et conseiller départemental du Cher, et elle est financée principalement par le Conseil départemental et l’État. C'est dire si elle est indépendante.
 Je me souviens avoir assisté à l'une de ses réunions, lorsque j'étais encore rédactrice en chef d'un journal local. J'avais eu l'impression d'être à une messe. Le prédicateur – le directeur de l'époque de la centrale de Belleville-sur-Loire, François Goulain – avait fait un long discours vantant les mérites de son site. Il faisait chaud ; l'assistance semblait somnoler. Un militant anti-nucléaire avait bien posé une ou deux questions, auxquelles François Goulain avait répondu avec son sourire habituel. Tout le monde s'était réveillé au moment de parler du Grand Carénage. Oui, ça, c'était important : les travaux de prolongation de vie de la centrale nucléaire. Pour des raisons de sécurité ? Mais non : les élus voulaient savoir où et combien de logements seraient construits pour les employés, histoire d'en attirer quelques-uns sur leurs communes et, peut-être, de relancer l'épicerie, l'école, le club de football…
Je me souviens avoir assisté à l'une de ses réunions, lorsque j'étais encore rédactrice en chef d'un journal local. J'avais eu l'impression d'être à une messe. Le prédicateur – le directeur de l'époque de la centrale de Belleville-sur-Loire, François Goulain – avait fait un long discours vantant les mérites de son site. Il faisait chaud ; l'assistance semblait somnoler. Un militant anti-nucléaire avait bien posé une ou deux questions, auxquelles François Goulain avait répondu avec son sourire habituel. Tout le monde s'était réveillé au moment de parler du Grand Carénage. Oui, ça, c'était important : les travaux de prolongation de vie de la centrale nucléaire. Pour des raisons de sécurité ? Mais non : les élus voulaient savoir où et combien de logements seraient construits pour les employés, histoire d'en attirer quelques-uns sur leurs communes et, peut-être, de relancer l'épicerie, l'école, le club de football…
« Même la CLI ne savait pas pour le projet de « piscine » à Belleville. Elle a organisé une conférence de presse à la hâte après la sortie des articles de Reporterre. La preuve qu'elle ne sert à rien », soupire Françoise Pouzet.
____________________________________________________________
Une « piscine » de déchets à Belleville
____________________________________________________________
La « piscine ». L'annonce a fait son effet. Le mardi 13 février 2018, dans le magazine Reporterre (****), la journaliste Emilie Massemin révélait qu'EDF et l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) réfléchiraient à la construction d'un bassin de stockage de combustibles radioactifs usés. Le principe ? Les plonger dans une piscine durant soixante à cent ans selon les combustibles, afin de les refroidir avant… de les retraiter et les réutiliser selon EDF qui assure que, d'ici là, une technique imparable aura été trouvée… ou, dans le cas contraire, de les enfouir à Bure.
Si le choix d'EDF ne serait pas encore arrêté, le site de Belleville serait privilégié pour sa situation géographique centrale, son raccordement avec le réseau ferroviaire, ainsi que son emprise foncière (deux réacteurs sur les quatre prévus initialement ayant été construits).
Emilie Massemin affirme qu'entre 6.000 et 8.000 tonnes de métal lourd irradié provenant notamment des surplus de La Hague, pourraient être stockés à Belleville.
 Les militants anti-nucléaires jugent la méthode risquée. Dans un rapport rendu public en octobre dernier, Greenpeace souligne l'insuffisance des protections de ces piscines soumises aux risques sismiques, aux problèmes d'étanchéité, aux attentats…
Les militants anti-nucléaires jugent la méthode risquée. Dans un rapport rendu public en octobre dernier, Greenpeace souligne l'insuffisance des protections de ces piscines soumises aux risques sismiques, aux problèmes d'étanchéité, aux attentats…
« L'entreposage à sec semble plus sûr », souligne Françoise Pouzet. Les combustibles sont placés dans des conteneurs de plus de cent tonnes, puis dans des alvéoles en béton, en subsurface. Areva – devenue Ovano – connaît bien cette solution puisqu'elle la commercialise dans le monde entier. « C'est moins dangereux mais c'est plus coûteux... »
Le transport est l'autre point noir : entre deux sites, comment exclure les accidents, les attaques, les vols, les détournements ? Actuellement, des convois soit disant secrets sont déjà organisés chaque semaine, dans des semi-remorques banalisés mais escortés par la Gendarmerie. Non seulement l'organisation Greenpeace est parvenue à les retrouver mais en plus, à simuler une situation d'attaque sans être inquiétée…
Le matin de la sortie de l'article, un élu du Sancerrois m'appelle. Dans sa voix, un mélange de colère et de dépit : « Quand j'étais enfant, j'habitais en Bretagne et mon père était contre Plogoff. Aujourd'hui, je suis père de famille et j'apprends qu'une piscine de déchets radioactifs va être construite près de chez moi. Ce n'est pas possible comme l'Histoire se répète... » La plupart de ses collègues sont loin d'être de farouches opposants anti-nucléaires. Mais ils préparent un dossier de reconnaissance de leur belle région au Patrimoine mondial de l'UNESCO ; ils se seraient bien passés des projecteurs braqués sur la centrale et le projet de piscine…
_____________________________________________________
Pour soutenir Bure, un comité local
_____________________________________________________
Vendredi 23 février – 18 heures – La Brèche, centre social autogéré à Morogues
Dix jours après la sortie des articles dans Reporterre, l'Info-Tour de Bure fait étape à Morogues, à 45 kilomètres au sud de Belleville-sur-Loire. Deux opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires Cigéo, dans la Meuse, ont organisé une tournée d'information à travers la Région Centre, où ils vivent. Ce soir-là, c'est le centre social autogéré La Brèche qui lui ouvre ses portes. Une trentaine de personnes ont fait le déplacement pour y participer, principalement du nord du Cher et du Loiret. Je reconnais des militants de SDN, mais il y a aussi des citoyens sans étiquette venus simplement s'informer.
La soirée se tient dans un contexte particulier : la veille, 500 gendarmes ont procédé à l'expulsion d'une quinzaine d'opposants à Cigéo, qui occupaient le Bois-Lejuc.
 Ajoutez à cela l'annonce de la construction de « piscine » à Belleville-sur-Loire, et il n'en faut pas plus à certains pour s'engager dans le réseau anti-nucléaire. Même si la lutte est bien différente, la victoire de Notre-Dame-des-Landes est dans tous les esprits. Celle d'un peuple contre son Etat corrompu.
Ajoutez à cela l'annonce de la construction de « piscine » à Belleville-sur-Loire, et il n'en faut pas plus à certains pour s'engager dans le réseau anti-nucléaire. Même si la lutte est bien différente, la victoire de Notre-Dame-des-Landes est dans tous les esprits. Celle d'un peuple contre son Etat corrompu.
C'est ainsi, ce soir-là, qu'un comité local de soutien à Bure a vu le jour. Son rôle : informer la population du Cher, sur le projet de Bure en particulier et sur les dérives de la filière nucléaire en général ; et soutenir la lutte sur place.
Déjà, des membres du comité ont participé à l'action antinucléaire européenne du samedi 10 mars en déployant des banderoles sur les ponts autoroutiers et à la commémoration de la catastrophe de Fukushima le dimanche 11 mars à Paris.
Le comité du Cher n'est pas le premier du genre : il rejoint ainsi un ensemble de groupes de soutien déjà constitués sur l'ensemble du territoire français. Preuve, s'il en était besoin, de l'intérêt de la population pour ces questions cruciales, vitales.
________________________________________________________________________
Un agenda chargé dans les prochains mois
________________________________________________________________________
Le symbole de la radioactivité barré de rouge n'est pas prêt de quitter les esprits.
Dans le Cher, un week-end dense se prépare pour la commémoration de Tchernobyl, les 28, 29 et 30 avril ; les 14 et 15 juin, le Tour Alternatiba (mouvement climat) passera par Gien, Dampierre, Vierzon et Bourges ; en septembre, se tiendra la deuxième édition de « La Loire à zéro nucléaire » ; en octobre, une manifestation à Saint-Laurent-des-Eaux. Les petits drapeaux à fond jaune continueront à flotter au vent…
Fanny Lancelin
(*) Le 11 mars 2011, un séisme au large des côtes japonaises provoque un tsunami. Une vague de neuf mètres envahit le site de la centrale de Fukushima Daiichi ; les réacteurs entrent en fusion, les piscines de désactivation surchauffent. Des rejets massifs de radioactivité ont lieu. Les eaux, les sols et les plantes sont contaminées, les travailleurs de la centrale et les populations environnantes irradiées. La catastrophe de Fukushima a été classée 7 sur l'échelle internationale de gravité (INES) c'est-à-dire la note la plus haute.
(**) Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : www.irsn.fr
(**) Superphénix est un ancien réacteur nucléaire de grande puissance, situé dans l'ancienne centrale de Creys-Maleville. Après plusieurs incidents et d'importantes manifestations, il a été arrêté en 1997.
(***) Du 13 au 16 février 2018 inclus, Emilie Massemin a publié une série d'articles sur la filière nucléaire dans le magazine Reporterre : https://reporterre.net/EXCLUSIF-EDF-veut-construire-une-piscine-geante-de-dechets-nucleaires-a
(****) Parmi ces combustibles, du Mox : un mélange d'uranium et de plutonium, l'un des ingrédients de la bombe atomique.
Contacts
- Sortir Du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye : présidente, Françoise Pouzet ; secrétaire, Thierry Delanoy ; trésorière, Catherine Fumé.
Contact : https://sdn-berry-puisaye.webnode.fr/ - Réseau national Sortir Du Nucléaire : http://www.sortirdunucleaire.org/
- Comité local de soutien à Bure (Cher) : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.



