Notre (Ré)acteur du mois, David Ligouy, s'apprête à rejoindre la 25e Conférence des Parties (COP 25) au Chili. En quoi consiste ce rendez-vous international ? Que s'est-il passé durant les précédents ? Quel rôle ont-ils tenu dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
1968 : création du club de Rome, constitué d'universitaires, de chercheurs, d'économistes et d'industriels venus d'une dizaine de pays différents.
Dans « Le rapport du club de Rome », ils annoncent la fin de la croissance économique par épuisement des ressources de la planète et prônent une « croissance zéro ».
Cette position est une illustration de la prise de conscience, en particulier à partir des années 1960, des problèmes touchant au climat et, plus généralement, à l'environnement, dans des perspectives scientifiques, économiques et, bientôt, politiques.
Les premières conférences organisées par les scientifiques
Juillet 1971 : première conférence de Stockholm, en Suède, appelée « Study of Man's Impact on Climate » (SMIC).
Elle est organisée par le Massachussetts Institute of Technology (MIT) et l'académie royale des sciences de Suède. Elle réunit des scientifiques qui étudient les conséquences de l'activité humaine sur le climat.
Juin 1972 : deuxième conférence de Stockholm appelée « Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain » (CNUEH).
Elle est la première d'une série qui se déroulera à dix ans d'intervalle : à Nairobi au Kenya en 1982, à Rio au Brésil en 1992, à Johannesburg en Afrique du Sud en 2002 et à nouveau à Rio en 2012.
Cette conférence place pour la première fois les questions écologiques au rang des préoccupations internationales majeures.
Elle se conclut par une déclaration de principes à respecter dans le domaine de l'environnement et d'actions pour lutter contre les pollutions.
Elle crée un « Programme des Nations Unies pour l'Environnement » (PNUE), notamment actif dans le domaine du climat.
Juillet 1974 : conférence internationale de Stockholm, sur le thème de la physique du climat et sa modélisation.
Elle est organisée par deux agences des Nations Unies, l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le PNUE, soutenues par le Conseil International des Unions Scientifiques (ICSU en anglais).
Le but : créer un programme mondial de recherche sur le climat. Les participants sont principalement européens et américains.
Février 1979 : première conférence mondiale sur le climat à Genève, en Suisse.
Elle est à nouveau co-organisée par l'OMM, le PNUE et l'ICSU.
Les participants appellent toutes les nations à coordonner leurs efforts pour étudier le changement climatique.
1983 : « rapport Brundtland ».
L'assemblée générale des Nations Unies mandate 22 membres, placés sous la présidence de Gro Harlem Brundtland (première ministre de Norvège), pour traiter la question de l'incompatibilité entre développement et protection de l'environnement. Les groupes de travail aboutissent, en 1987, au rapport baptisé « Our common future » (Notre futur commun) dit aussi « Rapport Brundtland ». C'est là qu'est énoncé et explicité le concept de développement durable.
Sa conclusion ? La nécessité d'inscrire la préoccupation environnementale dans toutes les politiques gouvernementales.
Exemple de conséquences : en 1987, la Communauté Européenne modifie le traité de Rome (1) pour l'adapter aux recommandations du rapport Brundtland. Désormais, l'environnement devra s'inscrire dans toutes les politiques menées par la Communauté Européenne.
1985 : conférence de Villach en Autriche, sur le thème de l'effet de serre, du changement climatique et des écosystèmes.
Une centaine de scientifiques et représentants de 29 pays y sont réunis.
L'urgence d'actions concrètes apparaît. Mais les participants sont divisés : certains plaident pour des restrictions immédiates des émissions de gaz à effet de serre ; d'autres veulent privilégier la recherche et lever les doutes scientifiques avant de préconiser des mesures contraignantes pour les Etats.
Des études aux engagements concrets
Juin 1988 : grande conférence mondiale sur le climat à Toronto, au Canada.
Le thème des discussions est : « l'atmosphère en évolution : implication pour la sécurité du globe ».
Environ 400 délégués d'une cinquantaine de pays y prennent part, dont une centaine de scientifiques.
De nombreux journalistes sont également présents, la médiatisation de l'événement est importante.
La conférence aboutit à un texte, « L'objectif de Toronto », qui engage les pays participants à réduire de 20 % (par rapport à ce qu'ils étaient en 1988) les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2005.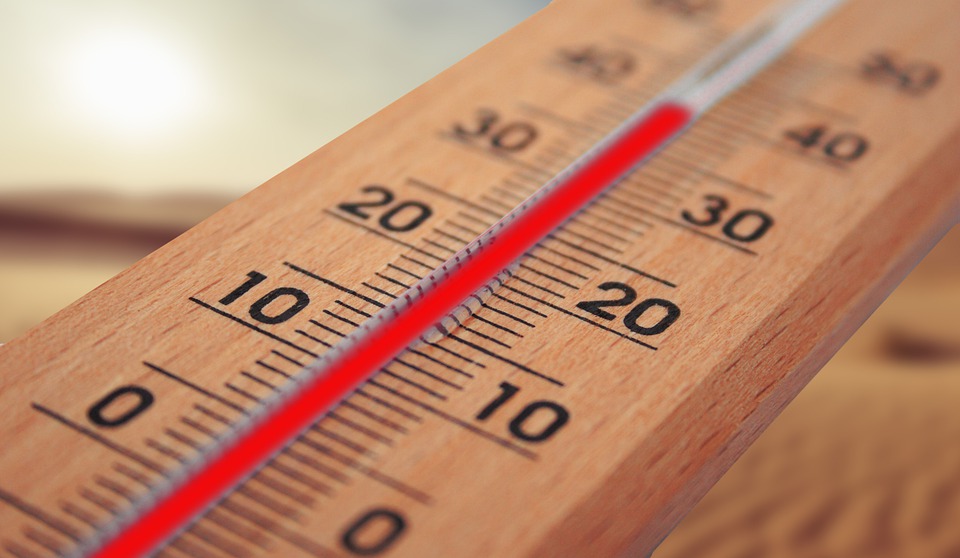
Autre fait notable : la création du GIEC, Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat. Né à la demande des membres du G7 (2), il réunit plus de 1.000 experts, représentant tous les Etats membres de l'OMM et du PNUE aux Nations Unies.
Sa mission : évaluer l'état des connaissances sur le changement climatique, proposer des adaptations aux perturbations causées par ce changement et des mesures pour l'atténuer.
Ainsi, il se compose de trois groupes de travail : le premier se charge des données scientifiques du changement climatique ; le deuxième, des impacts économiques, sanitaires et humains ; le troisième, des adaptations et atténuations. Ils sont co-présidés par un représentant d'un pays développé et un représentant d'un pays en voie de développement.
Le GIEC publie des rapports à intervalles réguliers (3), le premier datant de 1990 et le dernier de 2019.
Il recevra, en octobre 2007, le prix Nobel de la paix avec Al Gore, ancien vice-président américain, pour la réalisation de son film « Une vérité qui dérange ».
Octobre 1990 : deuxième conférence mondiale sur le climat à La Haye aux Pays-Bas.
Y participent 137 pays plus la Communauté Européenne.
La « déclaration ministérielle » qui en découle insiste sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans attendre que soient levées les incertitudes scientifiques, mais aucun objectif précis quantitatif n'est annoncé.
La conférence crée toutefois une « convention-cadre » qui sera mise sur pied en 1992 lors de la conférence de Rio et sera à l'origine du « protocole de Kyoto ».
L'entrée du politique dans la question du changement climatique
Du 3 au 14 juin 1992 : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain à Rio de Janeiro au Brésil.
Jusqu'ici, la question du changement climatique et de ses effets étaient surtout une affaire de scientifiques. Le rendez-vous de Rio marque un tournant. Désormais, la question s'imisce dans la sphère politique : il s'agit non plus seulement d'édicter des principes, mais de négocier des accords.
A Rio, plus d'une centaine de chefs d'Etats et de gouvernements sont présents, mais aussi 1.500 ONG (Organisations Non Gouvernementales). Le niveau de médiatisation est très élevé.
Au final, la « Déclaration de Rio » regroupe des actions, et rappelle aux Etats leurs droits et responsabilités en matière de gestion des ressources de la planète.
Quatre documents sont signés : l'Agenda 21 avec 2.500 recommandations ; une convention sur la protection de la biodiversité écologique ; une autre convention sur la lutte contre la désertification ; la convention-cadre sur le changement climatique.
1994 : entrée en vigueur de la convention-cadre sur le changement climatique dont le but est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropologique dangereuse du système climatique (…) dans un délai suffisant pour que l'adaptation aux changements climatiques des écosystèmes et des sociétés humaines soit possible. » (4)
La naissance de la COP
L'organe directeur de la convention-cadre est « la Conférence des Parties » plus communément appelée COP, qui rassemble les Etats signataires et se réunit annuellement. La COP a pour mission de mettre en pratique les engagements pris.
La COP 1 se déroule à Berlin en 1995 et la COP 2 à Genève en 1996.
1997 : COP 3 à Kyoto au Japon.
C'est durant cette conférence que naît le « protocole de Kyoto » qui aura cours jusqu'en 2012.
Il contient des objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre individualisés par pays ou groupes de pays, mais aussi des mécanismes de flexibilité comme le très controversé marché de permis d'émissions, et les conditions d'entrée en vigueur du texte : pour qu'il soit effectif, 55 pays représentant au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre sur la planète doivent le ratifier (5).
Des oppositions entre pays développés et pays émergents
D'énormes difficultés marquent le projet de protocole : seuls les pays dits développés sont soumis à des contraintes chiffrées ; certains, comme les Etats-Unis, veulent imposer les mêmes contraintes aux pays émergents, du Sud de la planète, dont on sait déjà que les émissions de gaz à effet de serre dépasseront bientôt celles des pays du Nord.
Les pays émergents et en voie de développement refusent, assurant que les pays les plus riches sont seuls responsables de la situation. Ils leur réclament des compensations, notamment financières, pour leur permettre de se développer « proprement ».
Désormais, chaque COP sera le théâtre de ces débats, au grand dam des ONG… Chaque pays souhaite avant tout défendre ses intérêts avant celui de la planète.
1998 : COP 4 à Buenos Aires en Argentine.
Elle échoue à mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Seul un accord sur le calendrier de travail est trouvé.
Même échec un an plus tard à Bonn en Allemagne pour la COP 5. Point positif toutefois : l'Alliance of Small Islands States (AOSIS) parvient à faire entendre sa voix pour alarmer sur les risques d'élévation du niveau de la mer dus au changement climatique.
2000 : COP 6 à La Haye aux Pays-Bas.
L'échec est total, à tel point qu'une COP 6 bis est organisée six mois plus tard à Bonn. Un accord y est finalement trouvé sur l'application du protocole de Kyoto mais sans les Etats-Unis.
Il est notamment décidé de créer un fonds destiné à aider les pays en voie de développement à faire face aux dérèglements climatiques.
2001 : COP 7 à Marrakech au Maroc.
Les Américains refusent de reprendre leur siège et restent en observateurs. Les accords de Marrakech sont surtout la traduction juridique du protocole de Kyoto.
2002 : COP 8 à New Delhi en Inde.
Le transfert de technologies des pays développés vers les pays pauvres sera favorisé pour atténuer l'impact du changement climatique dans le Sud de la planète.
Un an plus tard, lors de la COP 9 à Milan en Italie, le « Fonds pour l'environnement mondial » est renforcé. En 2004, lors de la COP 10 à Buenos Aires en Argentine, la dimension éthique du changement climatique est discutée.
Kyoto… et après ?
2005 : COP 11 et MOP à Montréal au Canada.
Le premier Meeting Of Parties (MOP) voit le jour, pour marquer la première réunion des Parties depuis l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto.
La participation et la médiatisation atteignent des records : plus de 10.000 délégués sont présents.
Le document final, « Le processus de Montréal », donne des pistes de recherche pour des accords post-Kyoto, c'est-à-dire après 2012.
2006 : COP 12 à Nairobi au Kenya.
La conférence des 168 Etats décide que la révision du protocole de Kyoto devra commencer en 2008. Elle sera fondée notamment sur le quatrième rapport du GIEC. Il est question d'élargir l'accord à des pays comme la Chine ou l'Inde, non concernés par la première phase.
Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) est mis en œuvre : il permet à des pays industrialisés d'investir dans des pays du Sud pour contrebalancer leurs émissions de gaz à effet de serre. Le Fonds d'adaptation est, quant à lui, destiné à parer aux impacts du réchauffement dans les pays pauvres.
2007 : COP 13 à Bali en Indonésie.
Un accord est conclu sur un calendrier des négociations pour la période post-Kyoto.
2008 : COP 14 à Poznam en Pologne.
Les participants s'accordent sur les modalités de financement du fonds spécial destiné aux pays les plus pauvres.
Il est proposé d'inclure la protection des forêts dans les mécanismes pour lutter contre le changement climatique.
2009 : COP 15 à Copenhague au Danemark.
Il s'agit de renégocier un grand accord international en prenant en compte les changements géopolitiques depuis le protocole de Kyoto et les nouvelles connaissances scientifiques mises en évidence par le GIEC.
L'objectif est désormais de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de moitié (par rapport à leur niveau en 1990) d'ici à 2050, pour éviter le seuil de réchauffement moyen de la planète à 2°C en 2100 (par rapport à ce qu'il était en 1850).
Mais l'objectif n'est pas atteint. Les dissensions sont nombreuses. Le texte finalement signé est une déclaration d'intentions sans ambition.
Septembre 2009 : troisième conférence mondiale sur le climat à Genève.
L'objectif est de faire progresser les services climatologiques et leurs applications dans les sociétés.
La participation est importante : 2.500 chefs d'Etats et de gouvernements, ministres, organisations internationales, scientifiques, fournisseurs de services météorologiques, décideurs économiques…
Les pays les plus pollueurs s'engagent à verser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 aux pays en développement, pour les aider à faire face aux impacts climatiques.
2010 : COP 16 à Cancun au Mexique.
Un processus visant à limiter l'exploitation forestière dans les pays en voie de développement est mis en place.
Mais les pays participants se révèlent toujours incapables de poursuivre ou remplacer le protocole de Kyoto au-delà de 2012, avec des mesures plus contraignantes.
Un changement d'approche est décidé : ne plus espérer d'accord global mais obliger les pays participants à déclarer ce qu'ils peuvent / veulent faire et s'y tenir.
2011 : COP 17 à Durban en Afrique du Sud.
Les 193 pays présents entérinent un accord avec une stratégie et une feuille de route qui, pour la première fois, n'engagent pas seulement les pays les plus riches dans le fonds vert pour le climat, mais des pays représentant la diversité des niveaux de développement, comme la Chine et l'Inde mais aussi les Etats-Unis.
2012 : COP 18 à Doha au Qatar.
La prolongation du protocole de Kyoto est décidée jusqu'au 31 décembre 2020.
2013 : Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain, « Rio + 20 ».
Les objectifs de la rencontre sont de faire entrer l'économie verte dans le concept de développement durable et de lui donner un cadre institutionnel.
Le texte ratifié par les représentants des 188 pays présents s'intitule « L'avenir que nous voulons ». Il déçoit, notamment les ONG, par son caractère déclaratif et non contraignant.
Cette conférence révèle des prises de position jugées irréconciliables entre certains pays. Les Etats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni brillent par leur absence.
Les espoirs font place aux déceptions et frustrations, sentiments qui ne se démentiront jamais, conférence après conférence…
Des conférences jugées (trop) peu concrètes
2013 : COP 19 à Varsovie en Pologne.
Cette conférence, et celle de Lima au Pérou en 2014, sont des rendez-vous de transition pour préparer la COP 21 prévue à Paris en 2015.
A Varsovie, est actée la reconnaissance des villes et des régions dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
2015 : COP 21 à Paris en France.
Les 195 pays signataires doivent publier officiellement leurs engagements individuels. Pour la France, il s'agit de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et d'abandonner progressivement les énergies fossiles.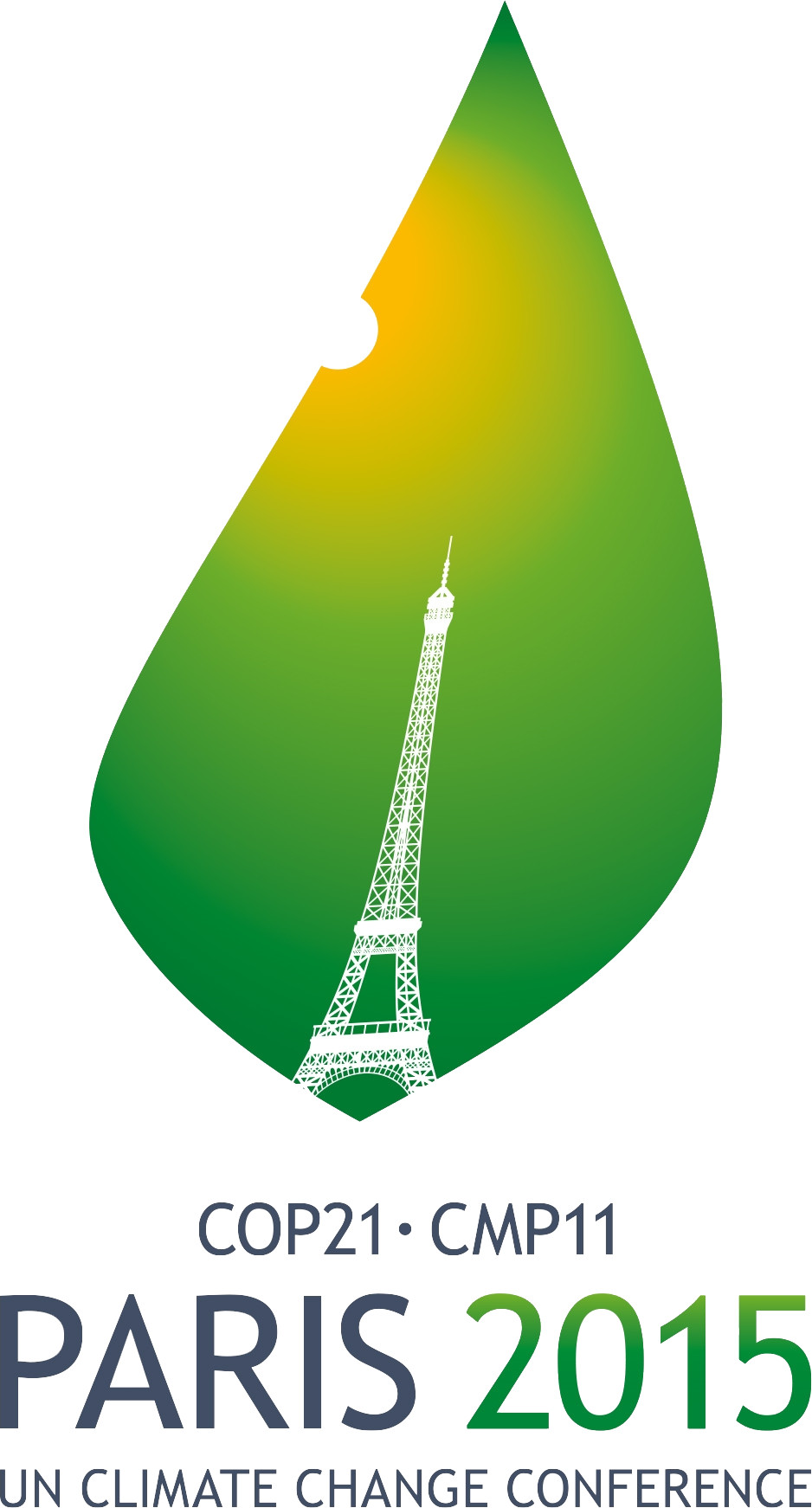
Mais un an plus tard, les Etats-Unis, et leur nouveau président Donald Trump, annoncent qu'ils se retirent de l'accord jugé trop contraignant pour l'économie américaine.
2016 : COP 22 à Marrakech.
Face aux déceptions de la COP 21, la rédaction du règlement de l'accord de Paris est avancée de deux ans, soit en 2018.
De nouvelles initiatives ont été annoncées comme un plan de protection des tourbières, les tourbières constituant le principal réservoir de carbone de matière organique au monde.
Mais les ONG dénoncent une nouvelle fois une COP d'intentions et non d'actions. Les fonds financiers promis aux pays en voie de développement se font attendre…
2017 : COP 23 à Bonn.
Rares annonces concrètes de cette rencontre : le lancement d'une alliance pour la sortie du charbon, à l'initiative du Canada et du Royaume-Uni. Elle compte notamment l’Angola, la Belgique, la Finlande, la France, l’Italie, les îles Marshall, le Portugal, le Salvador, mais aussi plusieurs Etats américains et provinces canadiennes. Les plus gros consommateurs de charbon sont toutefois la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est…
Aucune avancée notable en matière d'aide aux pays les plus pauvres, alors que l'année 2017 a été marquée par des événements climatiques exceptionnels.
Les Etats parties se sont quittés en promettant une année de dialogue pour dresser, fin 2018, un bilan collectif de leurs émissions de gaz à effet de serre.
2018 : COP 24 à Katowice en Pologne.
Les 200 pays participants ont défini les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Les ONG espéraient qu'ils réviseraient leurs engagements à la hausse pour 2020, mais les divisions étaient une nouvelle fois trop fortes.
(1) Traité de Rome : le 25 mars 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas signent à Rome deux traités : le premier crée la Communauté Economique Européenne (CEE) ; le second crée la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (CEEA ou Euratom). Ces deux traités sont entrés en vigueur le 14 janvier 1958.
(2) G7 : depuis 1975, le groupe des 7 se compose de l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Il se réunit chaque année pour discuter de problématiques mondiales, notamment économiques.
(3) Plus de renseignements sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec
(4) Texte de la convention-cadre : https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
(5) Texte du protocole de Kyoto : https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
(5) En France, le protocole de Kyoto a été adopté par décret daté du 22 mars 2005.
Rendez-vous au Chili
- La prochaine COP aura lieu à Santiago du Chili, du lundi 2 au vendredi 13 décembre 2019. Une période de pré-session est prévue fin novembre.
Elle a d'ores et déjà été surnommée « COP bleue » car le rôle des océans dans la lutte du réchauffement climatique devrait être largement mis en avant.
Autre point important de cette nouvelle rencontre : la définition des règles pour les marchés du carbone (article 6 de l’accord de Paris), non résolue lors de la COP 24. Plusieurs pays, dont le Chili, ont déjà annoncé leur volonté de neutralité carbone d'ici à 2050.
Les discussions devraient aussi s'intensifier sur les mécanismes d'aide aux pays les plus vulnérables face aux conséquences du réchauffement climatique.



