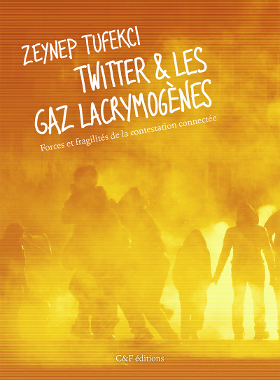Pour mobiliser et porter leurs revendications, les mouvements sociaux utilisent largement les technologies numériques. Mais comment expliquer que les résultats politiques ne soient pas à la hauteur ? Pourquoi Internet peut-il à la fois encourager et entraver les luttes ? Zeynep Tufekci s'est intéressée à ces questions en participant au Printemps arabe, au mouvement des parapluies à Hong-Kong ou encore celui d'Occupy à New-York.
Zeynep Tufekci est née en Turquie et vit aujourd'hui aux Etats-Unis. A l'origine développeuse informatique, elle se définit désormais comme « techno-sociologue ». Elle enseigne à l'université de Caroline du Nord et publie régulièrement des chroniques dans le New York Times.
Dans son ouvrage « Twitter et les gaz lacrymogènes – forces et fragilités de la contestation connectée » (Open editions), elle raconte comment les réseaux sociaux ont joué un rôle dans des soulèvements tels que les révoltes arabes ou encore les Indignés en Espagne, Italie ou Grèce… Elle était présente sur la place Tahrir au Caire en Egypte et dans le parc de Gezi à Istanbul en Turquie lors des soulèvements populaires contre les autorités.
Si elle reconnaît que ces réseaux apportent des témoignages cruciaux, en particulier lorsque les médias sont censurés, ou qu'ils favorisent des manifestations massives, elle relativise leur portée politique. « On ne tire pas nécessairement plus de profits d'une mobilisation plus facile », affirme-t-elle ainsi.
Elle fait un parallèle entre le mouvement pour les droits civils (contre la ségrégation raciale) en Alabama en 1955 et le mouvement Occupy (contre les inégalités) en 2011. Le premier s'est construit progressivement, méthodiquement et, lorsqu'il a décidé de boycotter les bus séparant les Noirs des Blancs, a lancé son appel via 52.000 tracts distribués par un réseau de 68 organisations afro-américaines. Les moyens n'étaient pas ceux d'aujourd'hui ; pourtant, ce mouvement a fini par obtenir des avancées politiques majeures. Le second est parti d'un e-mail du magazine Adbusters envoyé à ses 90.000 abonnés, déclenchant deux mois plus tard 600 occupations à travers les Etats-Unis et un mois plus tard, dans 650 villes partout dans le monde. Mais les politiques qu'il dénonçait sont toujours en place…
« Tout le travail organisationnel d'un mouvement ne sert pas seulement à l'organisation elle-même », rappelle l'auteure : elle expérimente et crée le type d'organisation souhaitée après le soulèvement populaire, la manière dont on peut penser collectivement, innover et poursuivre la lutte, malgré les différences et les obstacles. Cela suppose de vraies rencontres, discussions, des heures de travail.
Sans compter que les pouvoirs en place – économiques et politiques – ont appris à utiliser les médias numériques pour produire de la désinformation et pour démobiliser les activistes.
La spontanéité de manifestations encouragées sur les réseaux sociaux ne suffira pas. Pour vaincre, il faudra savoir les utiliser pour ce qu'ils sont : des outils, des moyens, pas une fin.
Plus de renseignements sur https://journals.openedition.org/lectures/37332