Les autrices (1) n'ont pas la visibilité qu'elles méritent. Leurs écrits seraient-ils systématiquement de moindre qualité que leurs homologues masculins ? Bien sûr que non. Elles subissent surtout la même discrimination que la plupart des femmes, dans une société occidentale dominée par les hommes. Une maison d'édition, Talents Hauts, les (re)met à l'honneur, notamment à travers une très belle collection, Les Plumées. Deux œuvres de Marguerite Audoux (lire aussi la rubrique (Ré)acteurs) font partie du catalogue.
Heureux hasard du calendrier : alors que la compagnie Poupées Russes mettait en scène « L'atelier de Marie-Claire » à Sainte-Montaine (lire aussi la rubrique (Ré)acteurs), l'ouvrage signé Marguerite Audoux était republié dans la collection Les Plumées, par la maison d'édition Talents Hauts. L'œuvre qui lui valut le prix Femina en 1910, « Marie-Claire », était déjà ressorti en mars dernier.
Sept autrices sont, pour le moment, entrées dans la collection :
- Renée Vivien (1877-1909), avec le roman « L'aimée ». Poétesse appartenant aussi bien aux mouvements littéraires du Parnasse, du Symbolisme, du Préraphaélisme que du Romantisme tardif, elle publia plus de 500 poèmes, des nouvelles, des volumes de prose, ainsi que deux traductions de poétesses grecques dont Sappho. Depuis 1935, un prix de poésie est remis en son honneur.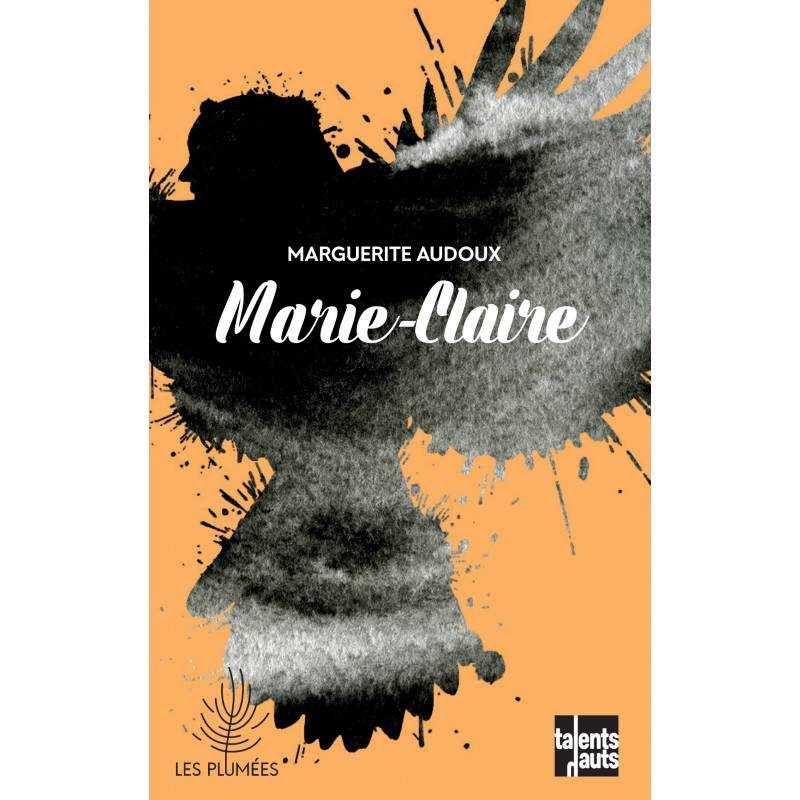
- Judith Gautier (1845-1917), avec « Isoline ». Fille de Théophile Gautier, elle fut la première femme membre de l’académie Goncourt. Poétesse, romancière, traductrice, journaliste et autrice dramatique, elle est à l’origine d’une œuvre originale et souvent méconnue.
- Gabrielle-Suzanne de Villeneuve (1695-1755), avec « La Belle et la Bête » dont elle écrivit la première version moderne en 1740. Mais son œuvre la plus remarquée en son temps fut « La jardinière de Vincennes » qui parut en 1753.
- Marie-Louise Gagneur (1832-1902), avec « Trois sœurs rivales ». Elle a publié des essais, des nouvelles et des romans. Son œuvre est marquée par son anti-cléricalisme et son engagement en faveur du pacifisme et d’une république sociale. Elle est entrée en 1864 à la Société des gens de lettres et a interpellé l’Académie française sur la féminisation des noms de métier. Elle a reçu la légion d’honneur en 1901.
- Renée Dunan (1892-1936) avec « Le jardin du bonheur ». Journaliste, essayiste, féministe, anarchiste, dadaïste et pacifiste, elle a écrit une cinquantaine d’ouvrages de genres variés : érotisme, aventure, historique, policier, psychologique, ésotérique, fantastique, science-fiction.
- Charlotte-Adélaïde Dard (1798-1862) « Avec les naufragés de la Méduse ». Elle est l'une des rescapés de ce naufrage, qu'elle raconte dans un récit publié pour la première fois en 1824.
- Camille Bodin (1792-1861) avec « Le monstre ». Considérée comme une autrice à succès de romans « frénétiques », son ouvrage fut censuré dès sa sortie en 1823. Il fut à nouveau disponible après sa mort en 1864.
- Marguerite Audoux (1863-1937) avec « Marie-Claire » et « L'atelier de Marie-Claire ». Placée à l’Assistance publique, bergère, servante de ferme dans le Berry, puis couturière à Paris, elle a écrit son premier roman en racontant son parcours à travers le personnage de Marie-Claire. Il a reçu le prix Femina en 1910 et a été traduit dans de nombreuses langues.
Des stratégies pour invisibiliser les autrices
A la lecture de ces biographies, on s'aperçoit que certaines de ces autrices ont rencontré le succès, avant de tomber dans l'oubli. D'autres sont parfois restées dans l'ombre. La collection vise à faire connaître des femmes qui ont été « dévalorisées, évincées, niées, censurées, rendues invisibles, spoliées, en un mot… plumées ! »
Comme le souligne l'équipe de la maison d'édition Talents Hauts, « les stratégies masculines pour « invisibiliser » les femmes qui écrivent sont nombreuses » : « s’inspirer : au XVIIe comme au XIXe siècle, les salonnières font émerger les idées, soutiennent les artistes, écrivent elles-mêmes et... s’effacent derrière leurs protégés » ; « s’approprier un travail collectif : l’effet Matilda, identifié dans le domaine scientifique, existe aussi en littérature... » ; « piller : les cas de plagiat répertoriés ne sont sans doute que la partie émergée de l’iceberg » ; « stigmatiser par des propos ouvertement misogynes (Flaubert, Baudelaire...) » ; « décrédibiliser : les appellations de « précieuses ridicules », « bas-bleus » n’ont pas d’autre but » ; « omettre : Bourdieu lui-même, parlant de la domination, oublie de citer Beauvoir dont il s’inspire pourtant largement ».
Les stratégies pour publier revenaient souvent à entretenir ce sentiment d'illégitimité, comme utiliser le nom de son mari ou de son père, voire un pseudonyme masculin. Pourtant, des autrices sont tout de même parvenues à se faire connaître et il n'a pas été difficile à la maison d'édition Talents Hauts d'établir une liste, depuis le Moyen-Age jusqu'au XXe siècle. « Retrouver, rééditer, réhabiliter les femmes de lettres « plumées » a un double objectif, précise l'équipe. Montrer aux jeunes lecteurs et lectrices d’aujourd’hui que la littérature s’est toujours conjuguée au féminin et leur faire prendre conscience de l’immense gâchis de talents que constituent la domination masculine et le patriarcat. »
Toucher l'Education nationale
Car la maison d'édition Talents Hauts s'adresse en premier lieu à la jeunesse : indépendante, elle a publié, depuis sa création en 2005, plus de 300 titres à destination des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Elle définit ses choix éditoriaux comme « singuliers, engagés et diversifiés ». Si les œuvres sont retenues en fonction de leurs qualités narratives et / ou graphiques, elles doivent également être exemptes de stéréotypes. C'est ainsi que la maison d'édition s'engage clairement contre toutes les formes de discriminations.
Par exemple, la collection « Livres et égaux » regroupe des romans « qui tordent le cou aux clichés » tandis que la collection « Les héroïques » met en avant « ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans les manuels d'histoire » comme les femmes, les enfants, les handicapés, les immigrés, les colonisés…
La collection « Les Plumées » a aussi vocation à toucher l'Education nationale. Il serait en effet temps que les autrices entrent durablement dans les programmes scolaires. Certes, on étudie – parfois – Colette, George Sand ou Marguerite Duras au collège ou au lycée. Mais les femmes sont souvent les grandes absentes des études supérieures de Lettres. En 2017, pour la 9e fois au cours des vingt-cinq dernières années, aucune autrice n'était au programme de l'agrégation. Depuis 1994, 17 femmes seulement s'y sont retrouvées contre 223 hommes. Une pétition nationale avait été lancée par un collectif d'étudiant.es et d'enseignant.es, à l'intention de Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Education nationale (2). On pouvait y lire : « Les enjeux de la représentation des autrices dans les programmes d’agrégation sont pourtant nombreux : ils sont symboliques, car que retenir de ces programmes exclusivement masculins sinon que les femmes ne sont pas capables de produire des œuvres dignes d’être étudiées ? Ils concernent la recherche, l’édition et l’accessibilité de certains textes anciens (citons ceux de Christine de Pisan) ; ils ont trait à l’enseignement des œuvres dans le secondaire et dans le supérieur, puisque les œuvres au programme de l’agrégation sont souvent reprises dans des cours ultérieurs de tous niveaux. L’étude et la connaissance d’œuvres d’autrices, du contexte et des conditions dans lesquelles les femmes ont écrit au cours des siècles doit faire partie de la formation des enseignant.e.s à l’égalité de genre, et cette formation ne peut être cantonnée hors de leur discipline. »
Le travail de maisons d'édition telles que Talents Hauts mais aussi de compagnies comme Poupées Russes ou de lieux culturels tels que le musée Marguerite-Audoux (lire aussi la rubrique (Re)visiter) doit permettre de valoriser notre matrimoine : tout ce que nous avons hérité et que nous hériterons des femmes et qui constitue, autant que le patrimoine, le ferment de notre histoire et de notre culture.
Plus de renseignements sur http://www.talentshauts.fr/41-les-plumees
(1) Ce terme existe depuis l'Antiquité et convient parfaitement à celles dont nous parlons ici. La chercheuse Aurore Evain le rappelle dans une émission passionnante : https://www.franceculture.fr/litterature/autrice-la-tres-vielle-histoire-dun-mot-controverse
(2) https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-pas-d-agr%C3%A9gation-de-lettres-sans-autrice
Le deuxième texte
- Une plateforme web, en cours de développement, conçue par #HackEgalitéFH met à disposition des enseignant.es des textes écrits par des femmes, accompagnés de contenus pédagogiques. L'objectif : « donner plus de visibilité aux autrices dans les programmes scolaires, afin que les jeunes puissent s’identifier à des figures fortes, sans distinction de genre ».
Le projet est désormais porté par une association créée en 2017 et intitulée Le deuxième texte.
Il se présente à la fois comme un blog, où sont publiés des articles en rapport avec le matrimoine littéraire, et un moteur de recherches. Rendez-vous sur https://george2etexte.wordpress.com/



