La coopération est le fondement du développement humain. C'est sur cette affirmation que s'appuie le sociologue et philosophe américain Richard Sennett dans son ouvrage « Ensemble : pour une éthique de la coopération » (1), pour démontrer à quel point la coopération est nécessaire à l'être agissant et pensant, l'homo faber. Pour faire, donc – des choses, des relations sociales, des environnements – mais aussi pour s'émanciper.
Richard Sennett est né en 1943 à Chicago, aux Etats-Unis. D'abord musicien, il a été encouragé à se tourner vers la sociologie par sa professeure, Hanna Arendt (2). Il enseigne aujourd'hui à l'université de New York et à la London School of Economics. Il appartient au mouvement philosophique du pragmatisme, courant américain proche d'une méthode scientifique, qui s'intéresse aux conséquences pratiques d'une théorie.
A partir de 2008, Richard Sennett s'est consacré à une trilogie d'essais, dont le personnage principal est l'homo faber. Hanna Arendt différenciait l'animal laborans – absorbé par sa tâche, qui ne fait que produire et est amoral – de l'homo faber – qui œuvre pour le bien commun, capable de juger de façon éthique son travail. Travail étant pris au sens d'activité.
L'artisan : une capacité de penser dans le faire
Richard Sennett s'est opposé à la vision de son ancienne professeure, notamment dans le premier tome de sa trilogie, intitulé « Ce que sait la main, la culture de l'artisanat » (3) : pour lui, l’artisan (au sens large de celui qui fait) fait preuve d’intelligence lorsqu’il met en œuvre son savoir-faire pour créer et fabriquer. La conception est indissociable de l’exécution, comme la tête l’est de la main. Seul existerait donc l'homo faber.
Il regrette que les sociétés capitalistes modernes aient institué un clivage entre la théorie et la pratique, l’artiste et l’artisan, le travail intellectuel et le travail technique.
A travers l'analyse de métiers artisanaux (potier, tisserand, souffleur de verre…), il explique l'importance de la préhension (terme qui désigne ici les mouvements dans lesquels le corps anticipe et agit), et de l'expérimentation pour qu'émerge une capacité de penser dans le faire.
Il tente de démontrer à quel point la routine est nécessaire pour faire émerger les compétences, mais aussi et surtout, l'innovation et la création. Pas de génie, mais bien du pragmatisme.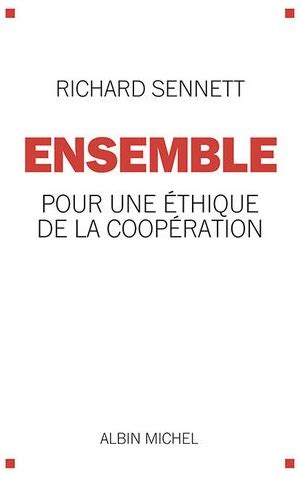
Dans ce premier essai, Richard Sennett s'intéresse également à l'aspect politique de l'artisanat. Il serait un modèle d’organisation sociale du travail à suivre en vue de l’établissement d’une société « meilleure ». Dans un article, la sociologue Anne Jourdain, met un bémol à cette affirmation : « En quoi le travail sur des objets matériels dans la sphère productive (fût-il un travail de coopération et de coordination) permet-il effectivement d’améliorer nos rapports avec autrui dans la cité ? Si le lien entre aptitude au travail et aptitude au politique est si peu discuté [ici], c’est sans doute parce que l’auteur n’interroge pas les préceptes de sa propre famille philosophique. Il écrit lui-même en conclusion : « On pourrait dire que le pragmatisme moderne prend pour argent comptant la conviction de Jefferson : le fondement de la citoyenneté est d’apprendre à bien travailler. » » (4)
La résistance politique du côté de la coopération
« Ensemble – Pour une éthique de la coopération » est le deuxième essai de la trilogie. Richard Sennett y poursuit son observation de l'homo faber, cette fois dans son rapport aux autres, notamment dans le travail.
Il introduit son propos par une expérience personnelle : celle qu'il a vécue en tant que violoncelliste au sein d'un orchestre. Une « coopération spéciale » (5), avec des personnes a priori très différentes les unes des autres, qui ont des modes de fonctionnement et des idées diverses. Ce qu'il avait observé alors pouvait-il être en fait un véritable modèle social ? Pouvait-il le vérifier dans une usine, des bureaux ? Quelle pouvait-être la relation entre la différence (qui caractérise chaque homo faber) et la coopération ? Qu'est-ce qui la rendait possible ?
Ici, la coopération ne signifie pas le compromis, mais plutôt une altérité et des différences reconnues et assumées, pour faire en communauté et faire communauté.
Pour Richard Sennett, le capitalisme moderne a délité la coopération. Le travail a été déqualifié et les inégalités sociales se sont creusées. Ce qui aurait dû renforcer la coopération ; au lieu de quoi, est né le concept de « solidarité », « une formule léniniste rigide », selon Sennett, qui « supprime l'action sociale » et « exige l'adhésion au lieu de la participation ». La solidarité, érigée en France en valeur suprême par les partis de gauche et les syndicats après la Première Guerre mondiale, engendrerait des « tribalismes », le « nous contre eux ». « Là où on a toujours à penser à la solidarité, on se prive de ce qu'il peut y avoir de plus créatif dans les formes de résistance politique à chercher du côté de la coopération », explique le sociologue et philosophe (5). Le danger majeur : un repli sur soi et l'absence de résistance collective. « En tant qu’animaux sociaux, nous sommes capables de coopérer plus profondément que l’ordre social en place ne l’imagine » (1), assure Richard Sennett qui prône « la communauté comme processus d’avènement au monde » et de vrais changements pour plus de socialité.
Comment pouvons-nous vivre ensemble ?
Le dernier ouvrage de sa trilogie s'intitule « Bâtir et habiter – Pour une éthique de la ville » (6). lI y analyse la relation entre la manière dont les urbanistes conçoivent les villes et la manière dont elles sont réellement habitées. Comment forme et fond peuvent se rejoindre ? Comment, dans ce cadre, pouvons-nous vivre ensemble ? La réponse du sociologue est « l'ouverture », de l'esprit de l'homo faber et de ce qu'il construit. « L’urbain compétent » sera celui qui sortira de son isolement, ira à la rencontre des autres, et ne cessera de jeter un regard renouvelé sur le monde qui l’entoure...
(1) « Ensemble – Pour une éthique de la coopération », traduit de l'américain par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 2014.
(2) Johanna « Hanna » Cohn Arendt (1906-1975), philosophe, politologue et journaliste allemande, naturalisée américaine. https://fr.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
(3) « Ce que sait la main, la culture de l’artisanat », traduit de l'américain par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 2010.
(4) Anne Jourdain, « Ce que sait la main », Sociologie [En ligne], Comptes rendus, 2011, mis en ligne le 8 février 2011 : http://journals.openedition.org/sociologie/685
(5) « Coopérer et faire société, avec Richard Sennett », émission « La suite dans les idées » du samedi 25 janvier 2014, présentée par Sylvain Bourmeau sur France Culture. https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/cooperer-et-faire-societe-avec-richard-sennett
(6) « Bâtir et habiter – Pour une éthique de la ville », traduit de l'américain par Astrid von Busekist, Paris, Albin Michel, 2019.



