J'ai fait le choix de ne pas enfanter. Ce choix n'est pas arrivé comme ça, en se levant un beau matin. Il est né d'une intuition, s'est affirmé au creux de profondes convictions, et s'est enraciné tranquillement mais fermement. Parce qu'il est le fruit d'une longue réflexion, je suis sereine. Je sais que je ne regretterai pas...
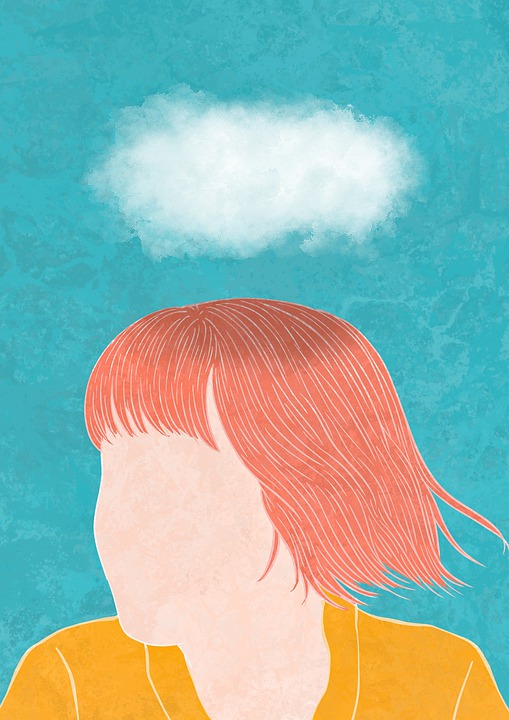
Bien sûr, tout au long de ma vie de femme, j'ai dû faire face à de multiples injonctions sociales. Aux remarques du type « Tu dis ça parce que tu es encore jeune », ont succédé les « Peut-être que tu n'as pas trouvé la bonne personne », remplacées aujourd'hui par des « Tu es trop radicale ! ». Je vais bientôt passer l'âge limite, j'ai eu le père parfait pendant plus de vingt ans sous la main et je ne serai jamais assez radicale à mon goût…
Une femme qui refuse d'enfanter. Que peut-elle bien être, aux yeux du monde ? Que peut-elle bien représenter aux yeux de toutes celles qui font le choix inverse : celui d'accueillir une autre vie en leur chair, de se dédoubler, pour finalement mettre au monde un nouvel être ?
Synchronicité. La même semaine au cours de laquelle ma gynécologue me demanda pour la énième fois si vraiment j'étais bien certaine de mon choix – parce que la date limite d'utilisation de mon utérus approchait semble-t-il ! – je reçus un e-mail qui me fit l'effet d'un signe. Aurélie (1) m'envoyait un compte rendu d'une réunion visant à organiser le soutien de Rose Faugeras, sage-femme accompagnant l'Accouchement A Domicile (AAD), radiée de son ordre professionnel. « Un prochain sujet pour (Re)bonds ? » me suggérait-elle.
Quelques jours plus tard, une autre amie, Alice, me proposait d'apporter son témoignage sur les deux AAD qu'elle avait vécues (2).
Ces femmes qui avaient fait le choix d'enfanter, d'une manière devenue si peu commune qu'elle en devenait suspecte, se tournaient vers moi, qui avait fait le choix de ne pas enfanter, pour transmettre leur message. Comment pourrais-je transcrire leurs désirs, leurs attentes, leurs sentiments ?
Certes, être journaliste, c'est être avant tout un·e passeur·se. Il n'est pas besoin de vivre réellement chaque expérience que l'on relate. Mais le sujet s'était présenté à un tel moment que je ne pouvais éluder la question. Qu'est-ce qui, dans ce sujet, me toucherait particulièrement, au point que je pourrais le défendre ?
Le libre choix. L'autonomie. Le droit de chacun·e à disposer de son corps. Le droit des femmes en particulier à ne plus être dépossédées de leurs responsabilités. Le pouvoir de dire : « Je suis prête. J'ai fait un long chemin pour arriver là. Je sais. J'assume. »
C'est ce chemin-là que nous partageons, et sur lequel nous retrouvons toutes les personnes qui luttent pour que soient vécus et respectés pleinement ces droits. Parmi elles, il y a Rose Faugeras.
_______________________________________________________
Une pratique qui suscite la méfiance
___________________________________________
Rose Faugeras est sage-femme libérale à Guéret dans la Creuse, dans la région de Nouvelle Aquitaine. De 2014 à 2019, elle a pratiqué l'accompagnement de l'accouchement à domicile. Malgré la distance géographique, elle a notamment assisté des familles vivant dans le Cher, comme celles de Maryline, Aurélie, Alice et Pauline (qui témoignent dans les rubriques (Re)découvrir, (Re)visiter et (Re)vue). Mais depuis le mois de mai, elle a décidé de suspendre toutes ses activités professionnelles.
Rose se trouve dans une situation délicate, pour ne pas dire douloureuse. Elle n'est pas la seule, mais son exemple illustre bien les obstacles que les femmes doivent aujourd'hui surmonter pour exercer leur droit à enfanter comme elles l'entendent.
En 2019, Rose a fait l'objet d'une plainte de l'ARS (Agence Régionale de Santé) suite à un problème infectieux rencontré par deux patientes aux lendemains de leurs accouchements. Orientées par la sage-femme vers l'hôpital, elles ont été soignées et ne présentent aucune séquelle, ni leurs bébés.
Le 3 décembre 2019, Rose a été convoquée devant la chambre disciplinaire interrégionale des sages-femmes du tribunal ordinal à Toulouse, qui lui reprochait un retard dans sa prise en charge. Verdict brutal en janvier 2020 : radiation à vie.
Spontanément, ses patientes ont constitué une association pour la défendre (3). Pour elles, le problème infectieux – rencontré également lors d'accouchements à l'hôpital – est une bonne aubaine pour les autorités. « Bien que l'Accouchement À Domicile (AAD) soit autorisé et encadré par la charte de l'association des sages-femmes libérales, en pratique, l'AAD suscite méfiance et rejet d'une partie du corps médical et des instances de pouvoir : ces trois derniers mois, déjà quatre sages-femmes ont été jugées », écrivent-elles dans une pétition lancée pour la réintégration de Rose.
Celle-ci a décidé de faire appel, ce qui suspend le verdict. La prochaine étape se passera devant la chambre disciplinaire ordinale nationale à Paris. La sage-femme est prête à aller jusqu'au Conseil d’État voire la Cour Européenne. C'est d'ailleurs pour conserver force et énergie qu'elle a décidé de stopper ses activités professionnelles, alors qu'elle aurait tout à fait le droit d'exercer jusqu'au prochain jugement (dont la date n'est pas encore connue).
Exercer avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête était trop difficile, m'explique-t-elle dans un échange par mail : « Je me sens en insécurité. C'est pourquoi j'ai choisi de faire une pause dans les suivis des AAD durant cette période et maintenant, de faire une pause professionnelle afin de rester dans de bonnes conditions physiques et mentales dans mes suivis. Je n'ai pas envie de vivre cette situation en permanence et que ça déteigne sur mes patientes. Je suis aussi très affectée et triste de notre situation francaise. Je me pose de multiples questions sur la reconnaissance et la légitimité des compétences de la sage-femme dans notre pays. Heureusement que toutes mes patientes m'apportent un immense soutien, ça me touche beaucoup. »
La situation française… quelle est-elle ? Pourquoi l'AAD est-elle si décriée, alors que les pays scandinaves, le Québec, la Suisse ou encore la Belgique le plébiscitent ? Quels freins (sanitaires, matériels, financiers, culturels) empêchent cette pratique de se développer ? Quels paradoxes soulèvent-ils ?
____________________________________________
Le rôle central des matrones
___________________________________
Peut-être l'avons-nous oublié mais longtemps, en France, les femmes accouchèrent chez elles. Jusqu'au XVIIIe siècle, en fait. « Evénement hors du commun malgré sa fréquence, l’accouchement, tout comme la mort, se passe là où vit au jour le jour et depuis des années une lignée familiale, dont le destin s’identifie à une maison, à un village, dont on fait partie et d’où l’on ne bouge guère », écrit Marie-France Morel, historienne et présidente de la Société d'histoire de la naissance (4). Les accouchements se déroulent alors au creux du foyer, dans la salle où se trouve le poêle, dans une atmosphère calfeutrée. Chez les plus pauvres, on choisit parfois l'étable pour profiter du foin et de la chaleur des animaux.
Les femmes peuvent enfanter seules ou, majoritairement, accompagnées d'autres femmes : « au centre, la matrone (appelée « la femme qui aide », ou la « mère mitaine », ou la « bonne mère ») est bien connue de tout le village ; elle est en général âgée, et donc disponible ; elle a appris son métier sur le tas, sans étudier. Souvent fille ou nièce de matrone, il lui a suffi de réussir quelques accouchements pour avoir la confiance des villageoises ; elle ne sait en général ni lire ni écrire, et le curé qui surveille ses compétences ne lui demande que de savoir réciter les formules du baptême, au cas où elle devrait ondoyer un nouveau-né mal en point », explique Marie-France Morel. Autour de la matrone, les parentes, amies, voisines qui préparent le lit, les linges, le feu, le fil… Elles partagent leurs conseils, tentent d'apaiser la parturiente (5), s'occupent du bébé lorsqu'il sort. Les jeunes filles qui ne sont pas encore mères, les enfants et les hommes ne sont en principe pas admis·es. Excepté le père, qui est même invité à intervenir en cas de difficulté. Mais l'accouchement est avant tout une affaire de femmes. Comment pourrait-il en être autrement ?
A l'époque, « seules les pauvresses ou les filles mères, qui n’ont nulle part où aller, accouchent à l’hôpital, qui n’est pas un établissement de soins, mais un lieu d’assistance, où l’on recueille les malades pauvres ; on y meurt beaucoup plus qu’ailleurs, à cause de l’entassement et de la contagion des « fièvres » qu’on ne sait pas maîtriser. En temps ordinaire, 10 % des accouchées meurent, mais, à certains moments, la mort en emporte plus de la moitié », souligne Marie-France Morel. A domicile aussi, les risques sont importants : on estime alors entre 1 et 2 % les femmes qui meurent en couches ou des suites de leur accouchement.
_______________________________________________________________________________________
Une dépendance vis-à-vis des hommes et de la médecine
____________________________________________________________________
A partir du XVIIe siècle, des accoucheurs, hommes donc, font progressivement leur apparition, d'abord dans les milieux de la noblesse : il s'agit souvent de chirurgiens qui vont bientôt établir des traités d'obstétrique. Au départ réticentes, les familles font de plus en plus souvent appel à eux, y compris pour des accouchements sans difficultés, « au cas où ». La présence de ces hommes change considérablement les pratiques de la naissance : ils font sortir toutes celles qui entouraient autrefois la parturiente, au prétexte qu'il lui faut du calme et de l'air. « Il lui impose aussi la position la plus commode pour lui et la plus dépendante pour elle, en la faisant coucher sur le dos, ce qui est une gêne par rapport à la liberté des anciennes postures, écrit Marie-France Morel. Dans l’obstétrique savante du XVIIIe siècle, seule la position allongée sur le dos est convenable ; les autres positions sont condamnées au nom de la décence, car elles « répugnent à l’humanité » ; la femme qui les pratique peut être comparée à une bête ! »
On sait aujourd'hui que cette position est une ineptie. Naturellement, pour maîtriser la douleur, la plupart des femmes choisiraient d'accoucher debout, à quatre pattes ou sur le côté.
Les accoucheurs sont munis d'appareils « modernes » comme les leviers et les forceps, qui sont le privilège exclusif des hommes, médecins ou chirurgiens, puisque matrones et sages-femmes, même instruites, n’ont pas le droit de s’en servir. « Grâce à la pratique instrumentale, l’accouchement cesse d’apparaître comme un acte naturel : il nécessite le recours à un homme de l’art, à la fois savant et fort. C’est un premier pas vers la médicalisation de la naissance. »
A la campagne cependant, les matrones assurent toujours l'essentiel des accouchements. Mais elles sont bientôt les victimes de plaintes de la part des médecins : ils accusent leur ignorance de faire périr trop de mères et d'enfants. A partir de 1760, le pouvoir royal leur donne une formation : des cours itinérants sont organisés, notamment par la célèbre maîtresse sage-femme Angélique du Coudray (lire aussi la rubrique (Ré)créations). Des chirurgiens-accoucheurs lui succèdent et forment ainsi environ 12.000 sages-femmes.
Au XIXe siècle, elles doivent suivre des cours théoriques dans les facultés de médecine ou les hôpitaux. Les accouchements ont encore largement lieu à la maison : « Les hôpitaux restent encore des lieux effrayants qui n’accueillent que les filles mères ou les pauvresses. Les naissances y sont bien plus dangereuses qu’à domicile. »
_________________________________
Faire taire la douleur
__________________________
A partir des années 1840, la médecine occidentale découvre le pouvoir des drogues anesthésiantes. Dans les pays anglo-saxons, les femmes sont de plus en plus nombreuses à demander à « faire taire la douleur ». « Mais, paradoxalement, cette volonté des femmes d’abolir la douleur les conduit à dépendre plus exclusivement du médecin : car les sages-femmes, même les mieux formées, ne peuvent administrer les drogues, pas plus qu’elles ne sont autorisées à se servir des instruments. Seuls les hommes médecins savent doser les analgésiques et détiennent ainsi la possibilité d’un bon accouchement, sans douleur. Il faut donc recourir de plus en plus à eux, avec tout ce que cela implique de distance prise par rapport à l’ancienne sociabilité féminine de la chambre d’accouchement. » Dans le même temps, le médecin attire de plus en plus ses clientes vers l’hôpital qui tend à devenir un véritable espace de soins.
En France, ce sont les années 1920-1930 qui marquent l'essor de l'accouchement à l'hôpital, surtout en milieu urbain. Marie-France Morel retient deux raisons : l'encouragement de l’État par des aides couvrant les frais d'accouchement (pour faire face à la dénatalité) ; la transformation de l'hôpital en « haut lieu de technicité » avec des services dédiés à la naissance. A la campagne, l'accouchement à domicile reste majoritaire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. « À partir de 1952, l’évolution s’accélère : la majorité des accouchements ont lieu désormais en milieu hospitalier (53 % en 1952, 85 % en 1962). »
Mais, parallèlement, une autre mutation est en cours : « à l’initiative du docteur Fernand Lamaze (1890-1957), accoucheur à Paris à la Polyclinique des métallurgistes (rue des Bluets), est mise au point une méthode d’accouchement « sans douleur », inspirée des recherches de médecins soviétiques ». Il s'agit d'une « préparation psychique et physique agissant sur l’anxiété ». En 1952, 500 accouchements de ce type sont réalisés. Bien sûr, la méthode a ses détracteurs mais à force de luttes, des associations de femmes notamment, obtiennent que les séances de préparation soient remboursées par la Sécurité sociale. Même le Pape de l'époque (Pie XII) donne sa bénédiction à cette méthode, levant les objections des plus fondamentalistes des Chrétiens attachés au « Tu enfanteras dans la douleur »...
Marie-France Morel conclut : « Le lieu où la femme accouche et où naît son enfant est bien plus qu’un simple espace de soins. Il participe à la symbolique et au mystère qui sont au cœur de toute naissance humaine. Il conditionne un certain nombre de gestes, d’attitudes et différentes formes de sociabilité. Autrefois, près de la cheminée familière, l’accouchée était accompagnée et rassurée dans son travail et ses douleurs par les femmes de sa communauté ; cette aide à la fois charnelle et morale était capitale, elle permettait de surmonter l’angoisse de mort qui entoure inévitablement chaque venue au monde. » L'historienne n'est pas nostalgique du « bon vieux temps » mais « force est de constater que la chaleur amicale et sécurisante des anciens accouchements à la maison s’est perdue avec le passage à l’hôpital : le lieu anonyme et aseptisé, le face-à-face distant avec un personnel inconnu et interchangeable, l’interventionnisme médical de plus en plus pesant sont peu faits pour rassurer ».
___________________________________________________________________
Une technicisation de la naissance contestée
_____________________________________________________
C'est sans doute pourquoi, les demandes d'accouchements assistés à domicile progressent. Les usager·e·s prennent désormais une place importante dans le champ de la santé et sont de plus en plus critiques sur la relation asymétrique médecin-patient·e. De même, « la technicisation de la naissance » est aujourd’hui contestée. « De nombreux travaux montrent en effet que la plupart de[s] interventions (rupture de la poche des eaux, administration d’hormones accélérant le travail, monitoring en continu, épisiotomie, césarienne, etc.) ne présentent pas d’avantages décisifs et, à l’inverse, entraînent des conséquences négatives sur la santé de la mère et de l’enfant, écrivent les membres de l'Association Professionnelle pour l'AAD (6). Cela commence à être reconnu en France, mais notre pays présente un retard d’environ trente ans par rapport aux nord américains et nord européens par exemple. »
Les accouchements assistés à domicile n’ont plus rien à voir avec ceux pratiqués avant l’apparition des antibiotiques, des ocytociques et des techniques obstétricales modernes. Et en France, les sages-femmes accompagnant les naissances à domicile ne sont plus les matrones d'autrefois : elles suivent la même formation qu'une sage-femme hospitalière. Elles n'acceptent ce type d'accouchements que pour les femmes dites à bas risques et, en cas de complications, elles les orientent vers l'hôpital le plus proche. Elles adressent leurs patientes en maternité pour une consultation pré-anesthésie et la grande majorité pour une ouverture de dossier obstétrical.
Elles disposent de matériel pour effectuer une surveillance du bien être fœtal (cardiotocographe et doppler fœtal), de médicaments d’urgence, de sets permettant la pose de voies veineuses périphériques à la mère... La plupart sont aussi équipées pour stabiliser une urgence vitale chez la mère (hémorragie post partum principalement) ou l’enfant (détresses respiratoires).
____________________________
« Soif de liberté »
______________________
Quel parcours a suivi Rose Faugeras ? Son envie de devenir sage-femme est apparue en Terminale : elle souhaitait comprendre le fonctionnement du corps humain, tout en apportant une aide à des personnes en ayant besoin. Elle était également sensible à la place des femmes dans la société, aux idées du féminisme ou encore au « self help » (7)... Entrée à la faculté de médecine de Limoges, elle a ensuite été admise en école de sage-femme. Durant quatre ans, elle a suivi des cours théoriques, pratiques, ainsi que des stages. Une fois son diplôme en poche, elle a assuré des remplacements d'une consœur libérale assistant des AAD, ce qui lui a servi de « compagnonnage ». Elle a ensuite ouvert son propre cabinet à Guéret.
Pendant ses études, elle n'a quasiment jamais entendu parler de l'AAD. « C'était réduit à des bruits de couloir, se souvient-elle. C'était bien décrié. En tant qu'élève, on sentait qu'il valait mieux ne pas aborder le sujet... » Elle connaissait cette pratique par ses parents : « Je savais que l'AAD faisait partie des droits de la femme. C'est par les récits d'accouchement de ma mère, qui a choisi d'accoucher dans une clinique de Châteauroux, avec des valeurs qu'elle recherchait (8), que j'ai appris quels sont les choix qu'une femme peut faire pour mettre au monde. Ensuite, j'ai vu des reportages ; puis j'ai toujours été entourée d'ami·e·s né·e·s à la maison sans que ce soit un débat. »
Pourquoi n'a-t-elle pas souhaité travailler dans une structure comme une maternité ? « J'ai soif de liberté. J'avais en tête tla façon dont je souhaitais agencer mon espace professionnel, le matériel à utiliser. Je voulais moi-même choisir mes conditions de travail. Avoir une bibliothèque à disposition des patientes, un espace thé / café pour la salle d'attente, utiliser des matériaux et produits écologiques, qu'il y ait aussi de l'art (tableau, sculpture...) Je souhaitais que mon lieu de travail soit adapté à un espace où j'aime prendre du temps... »
_____________________________________________________________
Un besoin d'accompagnement croissant
________________________________________________
Comme toute sage-femme libérale, le travail de Rose consiste à informer et préparer ses patientes, à les rencontrer tous les mois jusqu'à la naissance, puis à continuer le suivi jusqu'au post partum. « Ce sont des temps médicaux et de discussion où le couple peut formuler et clarifier ses propres projets de naissance. » Elle a ainsi répondu à de nombreuses demandes d'accompagnement en AAD. En France, certaines sont parfois non satisfaites, du fait du peu de sages-femmes à les proposer. « Cet accompagnement représente pour moi un idéal, un aboutissement en périnatalité, et une création d'équipe entre soignant·e et patiente adaptée et adaptable aux besoins et demandes des patientes et familles », souligne Rose.
L'AAD représentait 20 % de son activité, soit une à deux naissances par semaine. « Mes horaires de travail sont très importants : il m'est arrivé de travailler six-sept jours par semaine, entre 10 et 12 heures par jour, avec de temps en temps un départ dans la nuit, ou les week-ends et jours fériés. J'ai vu un besoin croissant et une demande de plus en plus importante des femmes. J'allais jusqu'à deux heures de route autour de Guéret, puis j'ai commencé à réduire mon secteur, puis à refuser des demandes car je ne pouvais pas plus... » La suspension de son activité signifie une difficulté supplémentaire pour l'unique consœur qui pratique aussi l'AAD sur son secteur, déjà sous-doté médicalement.
Après cinq ans de pratique et des relations « courtoises » avec l'ARS, la plainte est tombée comme un couperet. « Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me sens victime de violence institutionnelle. Je ressens un abus de pouvoir, une non volonté de comprendre. Je me sens vraiment jugée sans preuves. » Comment expliquer cette position ? Au-delà de son cas particulier, pourquoi les autorités n'encouragent-elles pas l'AAD, alors qu'elles encouragent l'hospitalisation et le maintien à domicile (rappelons que ni la maternité ni l'accouchement ne sont des maladies…) ? « Je n'ai pas encore toutes les clés de compréhension. C'est trop récent de mon côté et je n'ai pas assez de recul sur la situation, répond Rose. Ce que je vois et constate c'est que les droits de la femme sont bafoués. Il est très difficile pour une femme ayant un projet d'AAD de le mener à bien sereinement. La liberté de choisir le lieu de naissance est très contraint ; à mon sens, l'offre de soins n'est donc ni complète ni adaptée aux compétences de la sage-femme actuellement. »
________________________________________________
Un droit en faveur du libre choix
______________________________________
Le droit. Que dit-il, en France ? Aucune loi n'interdit d'accoucher seule ou n'impose de lieu pour ce faire. En revanche, le code de la Santé publique plaide pour une information complète et loyale. Pourtant, Rose assure que 90 % des couples qu'elle a rencontrés avaient beaucoup de difficultés à obtenir des informations sur l'AAD. « Cela ne fait pas partie de l'offre de soins. La plupart de mes collègues libérales, hospitalières, gynécologues et médecins ont tendance à désapprouver la demande des couples et à ne pas orienter vers un·e professionnel·le médical·e qui propose ce suivi… Généralement, les couples me contactaient grâce à leur réseau et leurs connaissances. »
Au niveau européen, le Parlement recommande plusieurs mesures afin d’intégrer l’accouchement à domicile au système de soin. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) affirme « le droit de la vie privée des parents de choisir le lieu de naissance, dont le domicile » et déclare que « les Etats membres de l’Union européenne ont un devoir d’action, c’est-à-dire qu’ils doivent prévoir une législation mettant en œuvre les moyens suffisants pour exercer cette liberté ». Mais la France n'a pas signé la charte…
Au niveau international, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié un guide pratique intitulé « Les soins liés à un accouchement normal », qui précise notamment l'importance du respect du choix éclairé de la femme quant au lieu de la naissance. De plus, en 2007, lors d'une conférence réunissant une soixantaine de pays, l’OMS a formulé des recommandations dont l'une d'elles rappelle : « Les éventuels systèmes parallèles de soins périnataux (que représentent par exemple les accoucheuses traditionnelles) doivent cohabiter avec le système officiel, et leur collaboration doit être maintenue au bénéfice de la mère. De telles relations, si elles sont établies sans aucune tentative de domination d’un système sur l’autre, peuvent être très fructueuses. »
Du côté des sages-femmes, leur code de déontologie reprend des articles du code de la Santé publique (9), notamment ceux qui définissent leur champ de compétences. « L’ensemble de ces compétences permet aux sages-femmes françaises d’assurer la surveillance d’une naissance et d’agir de manière adaptée en cas de complications. Il n’est fait aucune mention de lieu d’exercice ou d’interdiction de pratiquer à domicile », rappelle l'Association Professionnelle pour l'AAD.
_____________________________________________________________
Pas de risque supplémentaire à domicile
________________________________________________
Alors ? Qu'est-ce qui bloque ? Le risque de complications médicales ? Des recherches ont montré que pour des accouchements dont les conditions sont comparables et pour une population sélectionnée à bas risques, les taux de mortalité et de morbidité périnatales sont égaux à domicile et à l'hôpital, voire légèrement inférieurs à domicile (10). Réalisées à l'échelle internationale, ces recherches concluent que l'accouchement à l'hôpital ne peut se justifier sur la base de la sécurité.
En 2012, le conseil national de l'ordre des sages-femmes lui-même faisait référence à des études menées ,'année précédente pour affirmer que « d’autres lieux d’accouchement que l’hôpital ne présentent pas un sur-risque pour les femmes et les nouveau-nés » (11).
En France, comme dans l'ensemble des pays industrialisés, les AAD représentent moins de 1 % de l'ensemble des accouchements. Mais certains Etats font le choix de l'encourager comme les Pays-Bas où la proportion atteint 31 % ou encore l'Angleterre où, depuis 2014, le NICE (National Institute for health and Care Excellence) recommande l'accouchement à domicile pour les femmes en bonne santé.
Le principal « problème » ne viendrait-il pas de la gestion de la douleur ? Ou de l'image que chacun·e d'entre nous en avons ? Comment l'aborder sans la technique, la médecine, la péridurale ?
« Tu enfanteras dans la douleur », aurait dit le dieu chrétien à la première femme, Eve, en punition pour avoir croqué dans le fruit défendu de la connaissance (et en avoir fait profiter le pauvre Adam). Dans son ouvrage intitulé « Mettre au monde » (12), le journaliste et auteur Patrice Van Eersel rappelle la position de Françoise Dolto, célèbre pédopsychiatre et psychanalyste française, à ce sujet : « Il faut savoir que l'accouchement échappe à toute logique. C'est un état magique et c'est un instant archaïque. Le corps se divise en deux sans mourir. Et tout de suite, la mère et l'enfant ont besoin l'un de l'autre. Pour se consoler. Elle d'avoir perdu son œuf, lui son placenta. Et c'est cela, la fameuse douleur du « Tu enfanteras dans la douleur ». C'est la séparation. C'est l'angoisse de la division du corps, ce n'est pas l'accouchement et ses contractions. « Tu enfanteras dans la douleur » a un sens beaucoup plus général. L'enfant va petit à petit prendre son autonomie. C'est à la succession de ces séparations que faisait allusion la malédiction divine. » (13)
Bien sûr, les douleurs de l'enfantement ne sont pas des illusions. La médecine occidentale y répond aujourd'hui quasi systématiquement par la péridurale : 90 % des femmes françaises accouchent sous cet anesthésique. D'autres voies sont possibles. Considérant que les douleurs étaient principalement causées par la peur et donc, par des tensions empêchant le corps de faire sereinement son œuvre, des méthodes se sont concentrées sur deux axes : la connaissance du corps de la femme par la femme elle-même ; et des conditions d'accouchement les plus naturelles et rassurantes possibles (accouchement dans la pénombre et le calme, place de la compagne ou du compagnon…).
__________________________________________________________
La préparation, rempart contre la peur
______________________________________________
La plupart de ces méthodes se sont particulièrement intéressées au périnée, organe au rôle prépondérant durant l'accouchement, mais aussi plus généralement dans la sexualité (les deux étant intrinsèquement liés). 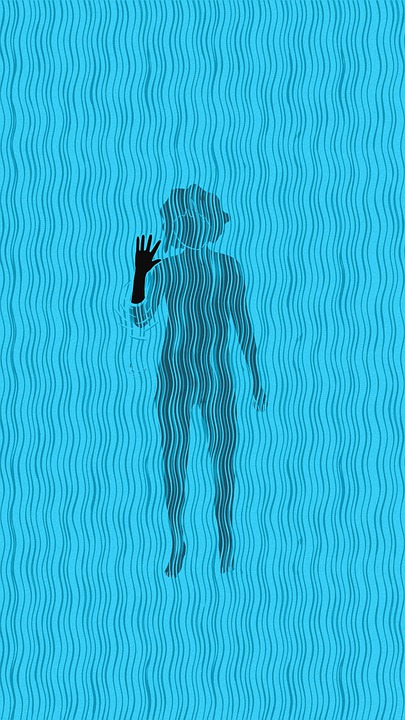 « L'héritage puritain des Occidentaux, associé à la vie sédentaire et au confort, nous a gravement coupé de nos corps et de nos sexes, qui nous demeurent largement inconnus malgré la « libération » sexuelle », écrit Patrice Van Eersel. Partout dans le monde, des sages-femmes apprennent aux femmes à explorer et entraîner leurs corps pour mieux en ressentir les mécanismes. Lorsque le vagin est musculairement fort, il laisse passer le bébé sans douleurs « crucifiantes ».
« L'héritage puritain des Occidentaux, associé à la vie sédentaire et au confort, nous a gravement coupé de nos corps et de nos sexes, qui nous demeurent largement inconnus malgré la « libération » sexuelle », écrit Patrice Van Eersel. Partout dans le monde, des sages-femmes apprennent aux femmes à explorer et entraîner leurs corps pour mieux en ressentir les mécanismes. Lorsque le vagin est musculairement fort, il laisse passer le bébé sans douleurs « crucifiantes ».
C'est pourquoi, la préparation à l'accouchement ne devrait pas se limiter à quelques heures. Selon le professeur René Frydman (14), pour être le mieux vécu possible, un accouchement doit être conscientisé ; la femme a près de neuf mois pour s'y préparer pleinement. Pourtant, la perspective de la péridurale lui enlèverait cet investissement. « Plus la médecine se fait interventionniste au moment de l'accouchement, plus elle devrait convaincre les femmes de « conscientiser » l'ensemble de leur grossesse, c'est-à-dire par exemple et en particulier, de s'impliquer dans une méthode de préparation sérieuse et profonde dès qu'elles se savent enceintes. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui se produit : délivrées de la peur de vivre un accouchement douloureux, un certain nombre (et peut-être un nombre certain) de femmes se déssaisissent en quelque sorte de toute une part de leur grossesse, qu'elles confient à autrui, aux blouses blanches, aux spécialistes. Le progrès technique se solde alors par un anti-progrès humain, une déresponsabilisation de la personne. » (15)
Ce que propose Frydman ? Que l'offre de la péridurale soit conditionnée à un engagement de la part des femmes à se préparer intensément. Le professeur remarque alors que parmi toutes celles qui ont joué le jeu, « un certain nombre finit par atteindre une telle confiance en elles-mêmes que finalement elles renoncent à l'anesthésie péridurale pourtant tant désirée au début, pour vivre l'ensemble de l'aventure avec leur forces propres – ce qui leur donne ensuite une confiance encore plus grande à vivre de manière autonome, leur accouchement leur ayant véritablement servi d'initiation ».
______________________________________________________________
Des associations et des fonds de soutien
_________________________________________________
Le choix du lieu d'un accouchement et de l'accompagnant·e est aussi, pour la femme qui s'apprête à enfanter, affaire de confiance. Ce choix doit être éclairé et non influencé par d'obscures a priori, conventions sociales, lobbies.
Le travail des sages-femmes, qui répond à un réel besoin, ne doit pas être entravé. Depuis 2002, la loi Kouchner les oblige à se doter d'une responsabilité civile professionnelle spécifique. Les compagnies d'assurance en ont profité pour monter les primes jusqu'à 25.000 euros par an ! L'enquête de l'Association Professionnelle de l'AAD réalisée en 2018 (lire les détails ci-dessous) a montré que les motifs de cessation d'activité sont liés à cette problématique, mais aussi aux pressions de la part d’autres professionnels, à la couverture insuffisante du territoire par les sages-femmes AAD engendrant des conditions de travail épuisantes et stressantes, et l’isolement.
La période que nous venons de vivre nous prouve que personne ne gagne à ce que les professionel·le·s du soin désertent des pans entiers de notre pays.
La résistance s'organise. Associations et collectifs de soutien à l'AAD se constituent. Ils réunissent familles, parents, professionnel·le·s mais aussi citoyen·nes désireux·ses de défendre le droit d'accoucher librement. Un fonds de soutien a vu le jour pour les sages-femmes qui, comme Rose Faugeras, font l'objet de plaintes considérées comme abusives. Pour que cesse l'hégémonie de la médicalisation et que chacun·e reprenne le pouvoir sur ce qui lui appartient : sa volonté et son corps.
Fanny Lancelin
(1) Lire aussi la rubrique (Re)découvrir.
(2) A suivre dans la rubrique (Re)visiter le 30 juin 2020.
(3) http://www.associationdedefensederose.fr/
(4) « Histoire de la naissance en France : XVIIe - XXe siècle » de Marie-France Morel, article paru dans la revue ADSP de décembre 2007-mars 2008 : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad612228.pdf
(5) Terme qui désigne la femme accouchant.
(6) Association Professionnelle de l'AAD : http://www.apaad.fr/aad-en-france/
(7) Self-help ou self-care : principe d'autonomie dans le soin.
(8) Clinique de Châteauroux : https://www.ch-chateauroux-leblanc.fr/categorie-offresoinsch/7/maternite-femme-mere-enfant
(9) Articles R.4127-306 et R.4127-318 du Code de la Santé publique.
(10) Peat, Marwick, Stevenson & Kellog, 1991 ; Janssen, Holt, Myers, 1994 ; Olsen, 1997 ; B.C. Home Birth Demonstration Project, 2000. Source : http://www.apaad.fr/aad-en-france/
(11) « Perinatal and Maternal outcomes by planed place of birth for healthy women with low risk pregnancies : the Birthplace in England national prospective cohort study – BMJ 2011 » et « Planned Home compared with planned hospital birth in the Netherlands – Obstetrics and Gynecology Vol. 118, N°5, November 2011 » cités dans Contact Sages-femmes (numéro 30, février 2012). Source : http://www.apaad.fr/aad-en-france/
(12) « Mettre au monde – enquête sur les mystères de la naissance » de Patrice Van Eersel (éditions Albin Michel). Lire aussi la rubrique (Ré)créations.
(13) p.54, « Mettre au monde – enquête sur les mystères de la naissance » de Patrice Van Eersel (éditions Albin Michel).
(14) René Frydman : obstétricien, gynécologue des hôpitaux de Paris et enseignant. Il est notamment célèbre pour avoir participé à la naissance du premier bébé-éprouvette français.
(15) p.90, « Mettre au monde – enquête sur les mystères de la naissance » de Patrice Van Eersel (éditions Albin Michel).
Une enquête précise sur l'AAD
- En 2018, l'Association Professionnelle de l'Accouchement Accompagné A Domicile (APAAD) a réalisé un état des lieux de la pratique en France :
- l'AAD représente aujourd'hui 2.000 naissances par an soit 0,25 % des naissances ;
- en 2018, 88 sages-femmes étaient identifiées sur le territoire comme pratiquant l'AAD ; elles étaient 122 sur les cinq dernières années ;
- elles avaient accompagné 1.347 femmes (ce qui comprend les femmes ayant commencé à accoucher à domicile et celles ayant entièrement accouché à domicile) ;
- la couverture du territoire est très inégale laissant place à de larges territoires non couverts par les sages-femmes AAD. Les secteurs où les conditions de collaboration avec les hôpitaux sont favorables sont mieux couverts. Les régions les mieux dotées se situent à l'ouest, en région parisienne et dans le sud ;
- l’âge moyen de la population AAD est de 32 ans ; celle-ci est donc plus âgée que la population générale accouchante dont l’âge moyen était de 30,5 ans en 2016 ;
- pour 34 % des femmes, il s’agissait du premier accouchement et pour 35 % du second enfant ;
- 84,6 % des femmes de la population étudiée étaient classées à bas risque strict, qu’il s’agisse des antécédents ou du déroulement de la grossesse ;
- la part de femmes ayant accouché la semaine du terme théorique est largement plus importante que dans la population générale. Il en est de même pour la part de femmes ayant dépassé le terme. L’absence de déclenchement artificiel du travail et la sélection des patientes expliquent ces résultats ;
- 12,7 % des accouchements ont nécessité un transfert per-partum que ce soit du fait d’une anomalie du travail ou afin de bénéficier d’une méthode d’analgésie médicamenteuse ;
- toutes les femmes ayant accouché à domicile ont accouché par voie basse non instrumentale ;
- 96,6 % des femmes ayant effectivement accouché à domicile ont présenté une délivrance normale et complète ;
- parmi les femmes ayant accouché à domicile, 65,4 % ont un périnée intact suite à l’accouchement, 33,7 % présentaient une déchirure du premier ou du second degré et seules 0,2 % une déchirure complète. Aucune n’a présenté de déchirure complète compliquée. Seulement 0,3 % des femmes a subi une épisiotomie. Parmi les femmes ayant présenté une déchirure périnéale, 53 % des cas n’ont pas nécessité de suture. Des résultats bien meilleurs que dans les accouchements hospitaliers ;
- dans le cadre de cette enquête, les femmes AAD sont en proportion 3,5 fois moins nombreuses que la population générale et 5,5 fois moins nombreuses que la population bas risque hospitalière à avoir développé une hémorragie du post-partum sévère ;
- l’ensemble des enfants nés à domicile sont nés vivants.
L'intégralité des résultats de l'enquête est à retrouver sur http://www.apaad.fr/wp-content/uploads/2019/09/ETAT-des-LIEUX-AAD-FRANCE-2018.pdf



