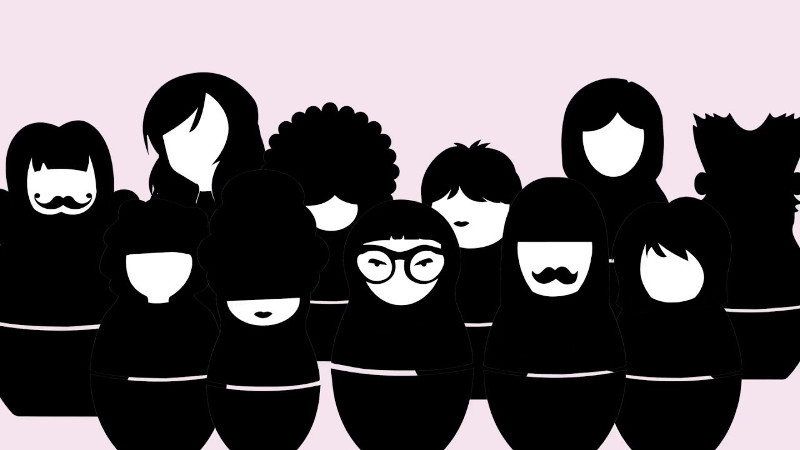Originaire de Rome, Danilo Proietti vit dans le Cher depuis près de dix ans. Engagé récemment dans une démarche de documentariste, il s'intéresse pour son premier long métrage au féminisme, avec un angle passionnant : quelle place les hommes peuvent tenir dans cette lutte ? A travers son expérience personnelle, ses réflexions politiques mais aussi intimes, il pose une question qui divise jusque dans les milieux militants. Il partage ici la note d'intention de son film.
Bien que depuis 1946, il soit inscrit dans le préambule de la Constitution que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme », 75 ans plus tard, la société française, et plus largement la société occidentale, peine encore à appliquer ce principe. Les discriminations de genre sont toujours nombreuses à tous les niveaux et ceci est rendu possible principalement par deux facteurs majeurs : la mentalité patriarcale, qui conditionne encore aujourd’hui nos rapports de genre, et le néolibéralisme qui est par essence, antinomique au concept d’équité, ce qui cause également toute une série de disparités.
C’est pour ces raisons que le féminisme reste aujourd’hui un axe majeur de la lutte pour une société vraiment juste, égalitaire et solidaire. On assiste à un lent décloisonnement des luttes sociales ; les militant·e·s de différents fronts réalisent enfin que les différents types de discriminations (de genre, d’ethnie, de religion, etc) et d’exploitation (de l’homme sur l’homme, de l’homme sur la femme, de l’homme sur la nature) ne sont que des métastases du même cancer social.
Malgré cela, le masculinisme est encore très présent, même dans les cercles militants, et l’égalité de genre n’est appliquée qu’en surface, notamment à travers l’écriture inclusive ou d’autres expédients. Il est encore très difficile de reconnaître que le comportement des hommes est biaisé par leur socialisation. Pour un souci d’efficacité dans la lutte, et par manque de temps, les rôles classiques se reproduisent, sans permettre l’émergence d’espaces d’expérimentation égalitaires et de renversement des imaginaires.
Mon rapport au féminisme
Je suis né et j’ai grandi à Rome. A ma naissance, mon père a soudainement réalisé qu’il n’était pas prêt à assumer son rôle. J’ai donc été élevé par ma mère avec l’assistance de ma grand-mère. Elles ont évidemment rencontré de nombreuses difficultés pour accomplir cette tâche.
Nous avons souvent été confronté·e·s aux fameuses « fins de mois difficiles » et j’ai vu ma mère se battre et mettre de côté ses passions et ses envies afin de m’élever correctement. Je l’ai vue se décourager et s’indigner, et puis se réconforter grâce aux mots de ma grand-mère, qui résonnent encore dans ma tête : « Ils en profitent parce que nous sommes deux femmes seules, mais on les emmerde ! ».
J’ai donc grandi en pensant avoir pleine conscience de ce que c’est d’être une femme dans cette société et, grâce à elles, j’ai appris à être respectueux envers tout être vivant.
Le seul mérite qu’aurait eu mon père dans mon éducation, aurait été de me présenter le modèle d’homme qu’il fallait à tout prix éviter.
Mon parcours m’a fait comprendre qu’une société juste n’est possible que si l'l'on dépasse les logiques de compétition et de domination, et si on élimine les privilèges et les discriminations.
Ce n’est que des années plus tard que je découvre ne pas avoir été exempt de certains comportements masculinistes. C’est la rencontre avec mon actuelle compagne, les discussions que nous avons eues à partir de la question du partage des tâches ménagères et notre progressif engagement dans des dynamiques militantes anticapitalistes, écologistes et féministes, qui m’ont ouvert les yeux.
Je découvre alors les effets de la socialisation genrée et la notion de patriarcat. Je m’aperçois que, malgré moi, j’ai des comportements genrés et que je bénéficie, en tant qu’homme blanc, de certains privilèges que la société accorde par défaut au genre dominant.
Cette perspective me bouleverse : d’un coup, je me retrouve dans le camp des dominants, alors que je me suis toujours battu pour contrer tout rapport de domination. Mon intégrité idéologique et politique risque de s’écrouler. A la prise de conscience douloureuse de la condition de la femme, s’ajoute une incohérence personnelle profonde entre d’une part mes idées et d’autre part mes actions et le contexte sociétal dans lequel j’agis.
Le changement de point de vue
Par ce film, je souhaite m’exposer (me mettre en scène) personnellement, en documentant mon chemin de déconstruction. Mon but est d’acquérir une compréhension objective des rapports de domination encore existants entre homme et femme, et de prendre conscience des enjeux des luttes féministes contemporaines. Mon parcours s'articulera entre la France, où j’habite depuis 2008, et l’Italie, les deux contextes qui m’ont façonné. Il s’agit de montrer que - malgré les différences entre ces deux pays - un problème systémique de la société globalisée y détermine les mêmes disparités et les mêmes comportements genrés. On verra donc que les enjeux du féminisme sont pratiquement identiques des deux côtés des Alpes.
Avec la collaboration de ma compagne, je suivrai les pistes de réflexions proposées par Léo Thiers-Vidal (1), en allant à la rencontre de femmes, d’hommes et de collectifs engagés. Je souhaite non seulement recueillir des témoignages, mais également participer à « des dynamiques collectives et militantes, contrôlées par les féministes » (2) en vue de transformer ma subjectivité masculine et de percevoir concrètement les dynamiques oppressives.
Ceci implique une répétition d’abandons momentanés des points de vue oppresseurs afin de faire une place intellectuelle et affective plus importante et plus permanente aux points de vue opprimés. Et c’est précisément ce « décentrement » - le renoncement à l’égocentrisme - qui permet de dépasser les modes d’engagements limités liés à une compréhension purement intellectuelle des théorisations féministes. La reconnaissance à un niveau ressenti du vécu opprimé des femmes, une analyse basée sur l’empathie neutralisent les résistances masculines aux théories féministes et ouvrent la voie à un investissement d’une autre nature, plus engagé, dans l’étude des rapports sociaux de sexe (3).
Ce qui sera mis en avant au fur et à mesure de l’avancement du film, ce sont les enjeux de la lutte, le vécu des opprimé·e·s et le changement de perception que j’espère acquérir dans le but ultime de contribuer au peu de pistes de réflexions qui existent actuellement sur l’implication concrète que les hommes peuvent avoir dans la cause féministe.
Je retournerai également sur les lieux de mon enfance, j'interrogerai les amis de toujours, ma mère, mais aussi les hommes qui m'entourent aujourd'hui.
La dramaturgie sera partagée entre des discussions auxquelles je participerai, des recueils de témoignages et des réflexions intimes mises en scène à travers la parole et/ou les images et/ou la musique que je compte composer moi-même.
Ainsi, la forme de ce documentaire ne sera pas exclusivement celle de l'enquête mais aussi celle d'un récit sensible et poétique.
Rencontrer des réalités engagées et variées
Parmi les personnes que je souhaite interroger, il y aura des universitaires, des journalistes, des bloggeur·ses, des youtubeur·ses ...
Et parmi les collectifs que j'aimerais inclure dans le documentaire : le Collectif Les Féministes Révolutionnaires basé à Paris.
Ce collectif a une vision révolutionnaire dans le sens où il·les mettent en avant les problèmes structuraux de la société. Selon eux·les, un vrai changement n’est possible que si la lutte se focalise davantage au niveau structurel qu’au niveau individuel. La question de la socialisation masculine, et des relations entre hommes et féminisme pourrait être approfondie avec il·les. Les moments de non mixité seraient notamment l’occasion d’approfondir mes connaissances sur cet outil de libération de la parole (lire aussi la rubrique (Ré)actrices).
En Italie, j'aimerais rencontrer une délégation du collectif Non una di meno, au centre social occupé ESC Atelier à Rome.
L’ESC Atelier est un espace occupé depuis une dizaine d’années par des étudiant·e·s, chercheur·se·s et précaires, dans le quartier étudiant de San Lorenzo.
Le lieu est très accueillant et les activités organisées sont ouvertes à tou·te·s : concerts, débats, projections, spectacles pour enfants, le festival L/ivre dédié en même temps aux maisons d’édition et aux vignerons indépendants, maraudes, assemblées de quartier, etc.
La question de l’égalité est mise en avant dans l’organisation de l’espace ; l’écriture inclusive est utilisée systématiquement dans les affiches et communications ; un espace permanent dédié aux enfants propose des jeux et des livres non genrés ; des affiches proposent la conduite adaptée à ce lieu, en s’appuyant sur les concepts de consentement, de respect et de liberté d’expression.
Non una di meno, collectif au rayonnement national, a organisé de nombreux ateliers d’écriture collective qui ont vu la participation de milliers de femmes et de personnes faisant partie des minorités de genre, afin d’élaborer un Plan féministe contre la violence masculine sur les femmes et la violence de genre.
Toujours à Rome, je m'intéresserai à Lucha y Siesta et La Casa Internazionale delle Donne, des collectifs qui proposent principalement des services d’accueil et d’assistance (juridique, psychologique et matérielle) pour les femmes en difficultés ou victimes de violences (y compris des migrantes). Avec elles, il sera possible d’approfondir la question de l’intersectionnalité et de recueillir des témoignages sur les violences faites aux femmes.
A Bourges, je suis déjà allé à la rencontre des Colleur-euse-s (lire aussi la rubrique (Re)visiter) qui font un travail d’affichage sauvage dans la rue, dans le but d’attirer l’attention des passant·e·s sur les thématiques du féminisme. Par exemple, le 8 mars dernier, elles ont organisé une visite guidée dans les rues de Bourges rebaptisées pour l’occasion en hommage à des femmes militantes. La participation du public était au-delà de leurs attentes, avec des retours très positifs.
J'ai aussi rencontré Leslouise, toujours à Bourges (lire aussi la rubrique (Ré)actrices). J'ai discuté avec une des fondatrices dans le but de mieux appréhender ses motivations.
Je m’entretiendrai également avec mes ami·e·s et camarades de La Coopération Intégrale du Haut-Berry. C’est un collectif inclusif qui cherche à se défaire de l’emprise capitaliste à travers l’autoproduction, l’autogestion et le travail socialisé. Nous abordons régulièrement la question de la charge mentale et du partage des tâches à l’intérieur du collectif, organisation plus complexe que celle d’un foyer.
Danilo Proietti
(1) Léo Thiers-Vidal (1970-2007) était un chercheur sociologue à l'École normale supérieure de Lyon spécialisé dans l'étude des masculinités. Militant libertaire engagé dans la cause féministe, il est l'auteur d'une thèse portant sur la conscience masculine de domination, intitulée : « De l'Ennemi Principal aux principaux ennemis : Position vécue, subjectivité et conscience masculine (2007) ». Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9o_Thiers-Vidal
(2) Léo Thiers-Vidal, « De la masculinité à l’anti-masculinisme : Penser les rapports sociaux de sexe à partir d’une position sociale oppressive », « Nouvelles Questions Féministes », Vol. 21, n° 3, décembre 2002, pp. 71-83. En ligne : https://remuernotremerde.poivron.org/uploads/2014/09/de-la-masculinite-a-l-anti-masculinisme.pdf
(3) Léo Thiers-Vidal, « De la masculinité à l’anti-masculinisme : Penser les rapports sociaux de sexe à partir d’une position sociale oppressive », « Nouvelles Questions Féministes », Vol. 21, n° 3, décembre 2002, pp. 71-83. En ligne : https://remuernotremerde.poivron.org/uploads/2014/09/de-la-masculinite-a-l-anti-masculinisme.pdf
Appel à participation
-
Le projet de Danilo Proietti étant toujours en construction, il reste preneur de propositions de témoignages, qu'elles émanent d'individu.e.s ou de collectifs, n'hésitez pas à le contacter : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.