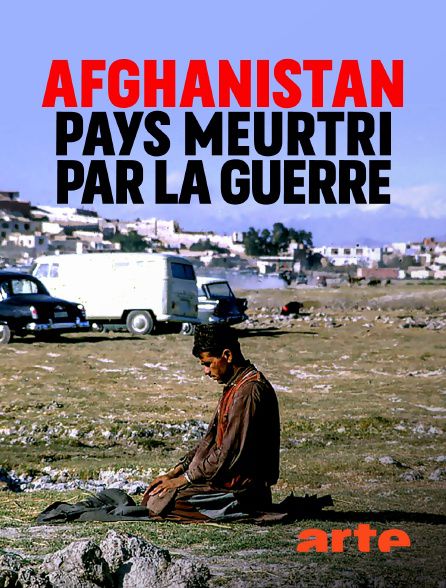C'est une formidable leçon d'histoire, précise, équilibrée, mais aussi émouvante, que propose cette série documentaire visible sur Arte. Quatre volets racontent comment l'Afghanistan est passé de l'ouverture sur le monde dans les années soixante, au repli et à la guerre sans fin aujourd'hui… La parole de personnages tels que des ex-dirigeants fondamentalistes, d'un Taliban, de soldats russes, de membres de la CIA ou de femmes engagées dans la lutte apporte des regards nouveaux sur les événements.
Produite par un collectif de sociétés européennes et arabes, la série a été écrite par Lucio Mollica et Claire Billet, et réalisée par Mayte Corraso et Marcel Mettelsiefen. Diffusée pour la première fois sur Arte en 2019, elle est de nouveau visible sur le site Internet de la chaîne. A travers quatre épisodes de 53 minutes chacun, elle couvre les cinquante dernières années de l'histoire de l'Afghanistan.
Le premier, intitulé « Le Royaume », s'ouvre sur des images impressionnantes de beauté : une vallée verdoyante baignée de soleil, des montagnes arides aux sommets enneigés, des cours d'eau généreux dans lesquels se baignent des enfants, des maisons construites au pied de rochers ancestraux, une ville grouillante d'activités et de lumières la nuit… « Ah ! Qu'il est beau mon pays ! proclame une voix off. Avec son ciel tel un océan suspendu. Regardez ces montagnes, nimbées de nuages. Regardez ces rivières, si larges et si belles. Dieu nous a donné tant de beauté ! Quel pays ! » Cette voix est celle de Masood Khalili, étudiant en médecine, devenu moudjahidine aux côtés du commandant Massoud, puis diplomate de 1996 à 2008. Il est aussi linguiste et poète. Il est l'un des personnages qui témoigne durant toute la série. A travers les anecdotes de sa propre vie, on comprend mieux les choix que les Afghan·es ont dû opérer.
La période du royaume, de 1964 à 1973, est aussi appelée « les dix années de démocratie ». L'Afghanistan était alors dotée d'une constitution et la famille royale, bien qu'autoritaire, souhaitait le pays ouvert. Aux touristes, aux hippies, aux capitaux étrangers… Les Russes vinrent avec leur argent et leurs idées de socialisme… Mais, dans ce premier épisode, on comprend aussi le fossé profond qui existait entre les mentalités de villes comme Kaboul, et celles qui régnaient dans les campagnes où les habitant·e·s restaient majoritairement pauvres et illettré·e·s. La religion y tenait une place essentielle et l'arrivée d'étrangers dans le pays était mal perçue.
Intitulé « L'armée soviétique », le deuxième volet de la série est consacré à la guerre contre les Russes, entré·e·s dans le pays en 1979 pour soutenir le gouvernement communiste alors menacé par les combattants islamistes venus des campagnes, les moudjahidines. L'un d'eux, devenu un dirigeant fondamentaliste, témoigne devant la caméra : Gulbuddin Hekmatyar a fait partie de la résistance afghane unie contre les communistes, avant d'être l'un des rivaux du commandant Massoud. Un membre de la CIA raconte comment les Occidentaux ont financé et armé la résistance, dans le contexte de la Guerre froide. Des soldats russes livrent aussi leur récit, de ce conflit impossible à résoudre qui a fait un million de victimes, et a obligé cinq millions de personnes à se réfugier en Iran et au Pakistan.
Le troisième volet s'intéresse à l'émergence des Talibans, au cœur de la guerre civile qui a suivi le départ de l'Armée rouge. Face au gouvernement resté communiste, la résistance afghane s'est déchirée, notamment les factions de Hekmatyar et de Massoud, faisant des milliers de morts à cause de leurs combats. On voit comment les Talibans ont gagné progressivement le soutien de la population, en promettant l'ordre et la justice. Ils sont arrivés au pouvoir en 1996. Ici, les témoignages de femmes telles que Sima Samar, ministre de la condition féminine afghane de 2001 à 2003, sont essentiels. L'épisode se termine par les funestes attentats du 11 septembre 2001 à New York, qui ont provoqué une nouvelle guerre.
Le titre du dernier volet, « Les troupes de l'OTAN », rappelle que les Américain·e·s n'étaient pas les seul·e·s engagé·e·s dans la lutte contre Al-Qaïda, l'organisation qui a permis à Oussama ben Laden de fomenter les attentats aux Etats-Unis. Pour le capturer, une véritable coalition internationale s'est mise en place. Et c'est parce que les Talibans avaient refusé de le livrer (et non pour libérer la population…) que les bombes se sont de nouveau abattues sur les Afghan·es. Certes, durant l'occupation occidentale, le pays a gagné en liberté. Mais les attentats suicides et les combats n'ont jamais cessé, et la pauvreté a touché toutes les composantes de la société. Un terreau fertile pour le retour des Talibans, qui ont regagné du terrain dès 2011, notamment dans les campagnes. C'est la même année que ben Laden a été retrouvé et abattu au Pakistan. Trois ans plus tard, l'OTAN quittait l'Afghanistan, tandis que les Etats-Unis préparaient leur retrait…
Pour voir ou revoir la série, rendez-vous sur Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019261/afghanistan/