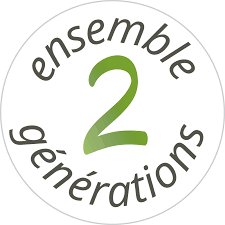« Pour désirer laisser des traces dans le monde, il faut en être solidaire. »
Simone de Beauvoir
La maison est grande, le jardin aussi mais aujourd’hui, tou·tes les enfants sont parti·es. Leurs chambres ne servent plus. Oui, bien sûr, iels passent parfois, restent éventuellement le temps d’un week-end ou d’un événement familial mais, la majeure partie de l’année, la maison est presque vide.
Presque. Car pour Rosa, Elisabeth, André, Françoise ou Nicole, pas question de la quitter : iels y ont vécu une belle partie de leur vie et, malgré leur grand âge, iels souhaitent y demeurer le plus longtemps possible (1).
En France, les seniors (2) représentent environ 20 % de la population et leur part ne cesse d’augmenter. La vie à domicile reste majoritaire pour près de 95 % d’entre elleux, les autres vivant généralement en institution. La cohabitation familiale, c’est-à-dire avec d’autres membres de la famille, est devenue progressivement marginale, en particulier pour les personnes âgées de plus de 85 ans (3).
Mais comment ne pas se sentir seul·e ? Et comment faire face à toutes les charges que représente une maison ? Comment continuer à vivre chez soi tout en restant en contact avec ce qui se passe à l’extérieur ?
Ces problématiques viennent rencontrer celles d’une autre génération qui, elle, peine à se loger décemment : celle des étudiant·es. C’est pourquoi, il y a quinze ans, la cohabitation intergénérationnelle solidaire est née. Un peu partout, dans des grandes villes mais aussi des zones plus rurales, des associations œuvrent pour mettre en relation des jeunes et des seniors, afin qu’iels partagent un même toit… et bien davantage !
Dans le département du Cher, « ensemble2générations » a vu le jour il y a cinq ans. Depuis, des « binômes » se sont formés à Bourges, Vierzon, Saint-Amand-Montrond...
_______________________________________________________________
Lutter contre plusieurs formes de précarité
__________________________________________________
Nathalie de la Perraudière a connu le problème du logement étudiant : lorsqu’un de ses enfants a souhaité poursuivre son cursus à Paris, elle a cherché une solution pour ne pas avoir à supporter un loyer exorbitant, comme la capitale en détient tristement le record. « Grâce à des amis, nous avons trouvé un logement chez une dame de cent ans », raconte-t-elle. Son enfant y est resté deux ans.
Désireuse de s’investir dans « une association avec du sens », cette expérience lui a donné l’idée de se tourner vers la fédération « ensemble2générations », créée en 2006 dans la région parisienne. L’objectif de la fondatrice, Typhaine de Penfentenyo : « lutter contre plusieurs formes de précarité » : la « solitude des personnes âgées souhaitant demeurer chez elles le plus longtemps possible » ; « la grande fatigue des aidants familiaux » ; la « difficulté qu’ont les étudiants à accéder à un logement » ; et « la nécessité de recréer du lien intergénérationnel ». (1)
En dix ans, l’association a essaimé des antennes dans une quarantaine de villes françaises, permettant ainsi la création de 5.000 binômes.
A Bourges, Nathalie de la Perraudière s’est lancée en 2015 après avoir suivi une formation de la fédération. Elle préside aujourd’hui l’antenne du Cher. « Notre association est indépendante du point de vue administratif et financier, précise-t-elle. Mais nous bénéficions d’outils pédagogiques et de l’expérience de toutes les personnes qui font partie du réseau. »
Elle consacre la majeure partie de son temps à faire connaître le principe de la cohabitation intergénérationnelle aux collectivités territoriales, aux associations de retraité·es, aux institutions telles que les Centres d’Action Sociale, les établissements médicaux… et bien sûr les établissements scolaires et toutes les structures en lien avec les jeunes. « Souvent, les gens connaissent cette solution mais ils ne savent pas que c’est possible ici, dans notre département, explique-t-elle. Il faut aussi lutter contre les a priori que chaque génération a sur l’autre. »
Chaque année, 5.000 étudiant·es font leur rentrée dans la capitale berruyère notamment dans des grandes écoles telles que l’IUT (4) et l’INSA (5) par exemple. Un nombre en constante augmentation depuis quelques années, les possibilités de formations s’y multipliant. Problème : l’offre de logements n’est pas adaptée à cette évolution. Nathalie de la Perraudière reçoit de plus en plus d’appels de jeunes, de 200 à 250 par an.
Parallèlement, le nombre de seniors augmente aussi. Au dernier recensement en 2017, iels représentaient 22 % de la population berruyère. Il s’agit donc de leur faire connaître la cohabitation intergénérationnelle solidaire, de les rassurer et de les convaincre de tenter l’aventure !
___________________________________________________
Un cadre juridique défini par la loi
________________________________________
Mais de quoi s’agit-il vraiment ? En France, la loi ELAN votée en 2018 et un arrêté datant de 2020 donnent une existence juridique à la cohabitation intergénérationnelle.
Avant tout, son objectif doit être « le renforcement du lien social » dans un rapport de solidarité. Elle concerne des jeunes de moins de 30 ans et des personnes âgées de plus de 60 ans. Il peut s’agir d’une location ou d’une sous-location à condition que le/la bailleur.se en soit informé·e. Si contrepartie financière il y a, elle doit être modeste et « librement convenue entre les parties ». Le/la jeune peut assurer des « menus services » mais en aucun cas remplacer un professionnel de santé ou de l’aide à domicile. Une convention d’hébergement doivent être signés entre les deux parties.
« Lorsque je suis en contact avec un senior qui se dit prêt à accueillir un jeune, je commence par une visite à domicile, explique Nathalie de la Perraudière. Ensemble, nous remplissons une fiche pour bien définir ce qui est recherché car il existe plusieurs formules. » La première propose un logement gratuit en échange de la présence de l’étudiant·e au dîner. « C’est une formule qui ne fonctionne pas très bien dans le Cher. »
Dans la deuxième, l’étudiant·e paie un petit loyer et peut rendre de « menus services » comme « sortir les poubelles, prendre le courrier, faire quelques courses, aider à se servir d’outils informatiques, mais aussi faire des jeux, se balader, regarder la télévision ensemble... » « Ce sont les binômes qui décident, en fonction de leur temps, de leurs envies. Mais souvent, il s’agit d’être ensemble au moment d’un repas. Ça brise le silence pesant. »
La troisième formule ressemble davantage à une chambre chez l’habitant « classique », avec un loyer toujours modéré mais sans contrepartie définie au préalable.
___________________________________________
« Un lien se crée vraiment »
__________________________________
Après la visite au senior, la présidente de « ensemble2générations » cherche l’étudiant·e qui lui correspondrait le mieux. « J’organise un entretien avec le jeune. Il est important pour moi d’avoir aussi un contact avec les familles, de l’étudiant comme du senior. Ensuite, nous visitons le lieu pour faire connaissance avec la personne accueillante et après une période de réflexion, si les deux sont partants, nous signons les papiers. La durée minimum de la cohabitation est de deux mois minimum à dix mois renouvelables. » Si tout se passe bien, un point est réalisé à la fin de l’année universitaire, notamment pour renouveler les conventions si besoin. Mais régulièrement, Nathalie de la Perraudière prend des nouvelles des binômes.
« Un lien se crée vraiment, assure-t-elle. Durant le Covid, certains sont restés confinés ensemble. Des jeunes qui ont terminé leurs études ou qui les poursuivent ailleurs prennent régulièrement des nouvelles des personnes âgées. J’ai l’exemple d’une jeune femme qui dîne tous les dimanches soir en visio avec son ancienne accueillante ! »
Elle souligne aussi l’intérêt de ce type d’hébergement pour les étudiant·es étranger·ères, tout de suite immergé·es dans la culture française.
_______________________________________________________________
Rassurant et avantageux financièrement
_________________________________________________
A Saint-Amand-Montrond, Danièle Revidon a ouvert sa porte quelques mois après avoir perdu son mari en 2018. Commerçante à la retraite, âgée de 83 ans, elle vit dans une maison qui possède quatre chambres. Comment a-t-elle connu l’association « ensemble2générations » ? « Par le bouche-à-oreille. C’est ma fille qui la connaissait par une amie… Je ne voulais pas rester seule. C’est grand ici. Je peux proposer de loger quelqu’un qui peut être indépendant quand même. Et puis, ça me fait un revenu complémentaire. »
Elle a d’abord accueilli Marianne, une jeune femme originaire du sud de la France, qui suivait une formation en bijouterie-joaillerie au lycée Jean-Guéhenno. « Je n’avais pas d’appréhension », assure Danièle. Bien sûr, chacune a dû s’adapter. Par exemple, Danièle, au fait que Marianne reste le week-end ; Marianne au fait de ne pas installer d’atelier de travail dans sa chambre… « Ce qui ne se passe pas forcément bien sert d’expérience pour les autres fois ! » relativise l’hôte.
Au départ de Marianne, elle a accepté de poursuivre la cohabitation, cette fois avec un jeune homme âgé alors de 17 ans, Gabriel Guillaumin. « Je viens de Châteauroux, je suis en deuxième année de CAP à Jean-Guéhenno », précise-t-il. Il a connu l’association « par un pur hasard » en tombant sur une annonce sur Internet. « Je ne voulais pas aller à l’internat, il y a trop de monde et pas assez d’heures libres. Pour mes parents, c’est plus rassurant et plus avantageux financièrement. »
____________________________________________________
Des seniors solidaires des jeunes
________________________________________
Tou·tes les deux se disent content·es de leur cohabitation. « A l’étage, je bénéficie d’une chambre, d’une salle de bain et de WC, détaille Gabriel. Nous partageons la cuisine. » Se donnent-iels rendez-vous pour le dîner ou pour d’autres moments ? « Ça arrive, oui, mais je ne veux pas qu’il change son rythme de vie pour moi », répète à plusieurs reprises Danièle.
Depuis qu’il est en stage et qu’il commence à 7 h 30, elle ne peut s’empêcher de lui préparer un thermos de café chaque matin. Gabriel sourit. « Si Madame Revidon est d’accord, je resterais jusqu’à la fin de mes études. »
Selon Nathalie de la Perraudière, certain·es seniors sont heureux.ses de se sentir solidaires des jeunes et suivent avec intérêt leur cursus. Leur proposer un petit loyer est un moyen d’éviter qu’iels ne travaillent en parallèle de leurs études et ainsi, qu’iels s’y consacrent pleinement.
D’après une étude commandée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), « la volonté d’aider les jeunes » est le deuxième élément qui déclenche l’envie de cohabiter chez les seniors, après « le besoin de présence ». Viennent ensuite le complément de revenu, « rassurer ses enfants », « rester dans le coup » et « apprendre quelque chose en particulier » comme une langue ou l’informatique par exemple. Les attentes des « menus services » apparaissent finalement peu. De plus, la totalité des personnes âgées interrogées pour l’étude et cohabitant déjà ont « le sentiment d’être utiles aux jeunes ». (7)
____________________________________________________________
Un contexte favorable à la cohabitation
______________________________________________
Depuis six ans, une centaine d’étudiant·es et une quarantaine de seniors ont accepté de jouer le jeu de la cohabitation dans le Cher. « Ensemble2générations » aimerait doubler ces chiffres. Parmi les freins : le réseau de transport en commun est insuffisant pour relier les villages aux centres de formation. La proposition ne répond donc pas à l’isolement des seniors en milieu rural. « Ça fait mal au cœur, reconnaît Nathalie de la Perraudière. C’est possible, nous l’avons fait à Fussy, mais il faut que le jeune ait une voiture. »
Le contexte social est pourtant favorable au développement d’une telle solution. Les seniors sont de plus en plus nombreux·ses et veulent rester chez elleux. On estime à 1,5 million le nombre de logements en France en sous-peuplement prononcé ou très accentué, occupé par un·e senior. Autrement dit, les logements d’au moins quatre pièces dans lesquels vivent un·e seul·e personne âgée. Couplez à cela les données sur les seniors envisageant sérieusement l’accueil de jeunes sous leur toit et vous obtiendrez un potentiel théorique de 850.000 accueillant·es (7).
La cohabitation intergénérationnelle solidaire bénéficie d’une bonne image : toujours selon la même étude, 84 % des personnes interrogées ont un avis positif sur le principe, 81 % chez les moins de 30 ans et 85 % chez les plus de 60 ans. Mais, parmi ces dernier·es, 23 % seulement l’envisagent pour elleux-mêmes. Au final, 61,5 % des jeunes intéressé·es ne trouvent pas de seniors pouvant les accueillir.
Le travail des associations comme « ensemble2générations » pour faire connaître le dispositif est donc essentiel pour que la solidarité entre les générations se poursuive.
Fanny Lancelin
(1) Témoignages à retrouver sur le site de « ensemble2générations » : https://ensemble2generations.fr/
(2) Nous avons choisi d’utiliser ici la définition de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), pour désigner les personnes de 65 ans et plus.
(3) Etude de l’INED (Institut National des Etudes Démographiques), « Habiter seul ou avec des proches après 85 ans en France », réalisée en 2016 et publiée en 2019.
(4) IUT : Institut Universitaire Technologique.
(5) INSA : Institut National des Sciences Appliquées.
(6) Loi portant sur L’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037639478/
(7) Etude réalisée par COSI Expertise pour la CNAV, « Cohabitation intergénérationnelle solidaire : quels leviers de développement », septembre 2020 : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/Cohabitation%20Intergenerationnelle%20Solidaire.pdf
Contact
- Ensemble2générations dans le Cher : 06.51.34.70.73. ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.