La non-mixité : une pratique valorisée lorsqu’elle est imposée par la classe dominante et condamnée lorsqu’elle est choisie par la classe opprimée. C’est ce que nous explique Ophélie, qui a suivi un master « Etudes sur le genre » et réalisé son mémoire sur la question de la non-mixité.
La non-mixité est un concept qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années, notamment suite à la popularisation de la pratique au sein des associations et des collectifs engagé·es dans les luttes sociales comme le syndicat étudiant UNEF, par exemple. Parmi les objections : la non-mixité serait excluante. Mais qui sont les personnes qui émettent ces critiques ? Il s’agit presque exclusivement de personnes habituellement issues de groupes dominants. Des groupes dominants qui pratiquent pourtant la non-mixité, notamment dans les milieux politiques. La différence majeure se trouve dans les raisons de la mise en place d’espaces et d’activités non-mixtes. On ne condamne que la pratique mise en place par les opprimé·es. Pourquoi ? Revenons sur le concept de non-mixité pour comprendre en quoi il est nécessaire de créer des espaces qui offrent sécurité et soutien aux personnes opprimées. Si l’on souhaite évoluer vers une société plus encline à favoriser l’égalité, voire l’équité (il est autorisé de rêver à l’idéal), il est essentiel de passer par la non-mixité.
Définitions
Commençons par définir ce qu’est la mixité. Le terme apparaît en tant que substantif dans les années 1950 comme directement associé à la mixité scolaire.
Pour autant, le terme mixte (1) est plus ancien et à la fin du XIXe siècle, il désigne « la coexistence des deux sexes (2) ».
Il faut attendre les années 1990 pour que la mixité s’ouvre à d’autres milieux que celui de la scolarité et à « d’autres diversités que celles des sexes [comme la] mixité sociale, mixité culturelle, mixité religieuse, mixité spatiale en relation avec la réflexion politique pour davantage d’égalité dans la société. (3) ». Lorsque l’on aborde le concept de mixité, il s’agit exclusivement d’une association entre ce qui est différent et semblable, il est malheureusement « très difficile de le percevoir comme multiple et complémentaire. (4) »
Au XXIe siècle, Le Petit Larousse propose une définition encore liée à l’école et au sexe des personnes : « Mixité n.f. Caractère d’un groupe, d’une équipe, d’un établissement scolaire comprenant des personnes des deux sexes ». On peut trouver une définition plus détaillée dans l’Encyclopædia Universalis en ligne qui propose notamment deux définitions : la mixité est le « caractère de ce qui est formé d’éléments de natures différentes » ou le « caractère de ce qui est composé de personne des deux sexes ». La mixité est donc un concept qui représente un ensemble de composantes différentes. Il s’agit d’un principe toujours communément utilisé pour désigner des êtres humains, notamment femmes et hommes.
La mixité existe sous différentes formes : nous pouvons par exemple penser au souhait politique d’établir une mixité sociale au sein de la ville. En effet, les politiques urbaines se sont imprégnées de la mixité et « dès le tournant du XIXe siècle, les premiers programmes de logements sociaux et leur intégration dans la ville [ont vu le jour] » (5). La mixité y est présente dans les esprits et tente de s’appliquer dans les pratiques.
La mixité dans le cadre des relations humaines peut être positive et nécessaire comme elle peut être rejetée, implicitement ou explicitement. On pense par exemple à des milieux tels que la politique qui est un univers encore très fermé aux femmes, un milieu qu’il est encore difficile d’identifier comme mixte. Cet exemple permet d’aborder la question de l’acceptation : il y a des temps et des lieux non mixtes (souvent en défaveur des femmes ou des minorités) qui ne posent que peu, voire pas de questions.
Puisque la mixité est l’ensemble de parties semblables, la non-mixité serait une division. On peut se rappeler ce que dit Caroline de Haas à propos de la critique de la pratique de la non-mixité : « (…) Quand 15 ou 20 femmes décident de se réunir entre elles, le nombre de tweets et de papiers que cela peut déclencher. Il se passe chaque jour à la surface de la planète des centaines de réunions politiques, syndicales, professionnelles composées à 100 % d’hommes sans que cela ne froisse personne. » (6)
L’autrice évoque ici la non-mixité entre les femmes et les hommes, mais dans la suite de son intervention, elle s’attarde sur les participants à ces réunions qui sont majoritairement des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels. La non-mixité de ces réunions « composées à 100 % d’hommes » dépasse donc largement le cadre exclusif du genre puisqu’il s’agit également d’une non-mixité raciale et économique.
Les non-mixités sont donc plurielles ; il existe de nombreuses variables.
Non-mixités imposées
Les non-mixités imposées et donc subies désignent l’exclusion des femmes, par principe, de toute vie politique. Il s’agit donc d’une situation qui « va de soi » et qui ne laisse pas le choix aux personnes qui sont exclues et qui deviennent petit à petit des personnes qui ne sont plus concernées.
Il s’agit d’une exclusion arbitraire, divisant la population sur des critères abstraits, tels que la condition biologique pour les femmes. En effet, afin d’exclure les femmes du monde public, les organisations d’hommes mettent en avant la nature fragile des femmes et leur rôle important au sein de la famille en tant que bonne épouse et bonne mère, ne laissant pas de place à une vie active en dehors du foyer.
Les non-mixités excluant les femmes existent donc depuis de nombreuses années. Mais ce système a commencé à poser question. L’absence de femmes dans le milieu de la politique a créé un fantasme poussant à croire que leur présence (qui amènerait à la mixité) suffirait à assurer l’égalité. Cette égalité en politique n’est pas numérique : elle est envisagée par les hommes plutôt avec 80 % d’hommes pour 20 % de femmes. On se rapproche ainsi de la mixité sans pour autant provoquer une féminisation du milieu concerné. La situation change sans être bouleversée ; les femmes restent majoritairement exclues.
La parité (qui se définit de deux manières : d’abord dialectique comme le fait d’être pareil·le, puis en mathématique comme un nombre pair) inquiète les hommes cis : l’exclusion ne se fait jamais sans crainte, pour les populations dominantes, d’un retournement de situation des populations dominées.
Comme le rappelle Caroline de Haas, la mixité ne garantit pas l’égalité. D’ailleurs, nous pouvons penser à Marcel Roncayolo, urbaniste et géographe français, qui a expliqué que « certaines mixités peuvent être ségrégatives. » (7) En effet, la mixité et la parité, qui symbolisent un ensemble égal de parts différentes, sont parfaitement présentes dans les familles et couples hétérosexuel·les. Pourtant n’est-ce pas aussi un lieu d’inégalités ?
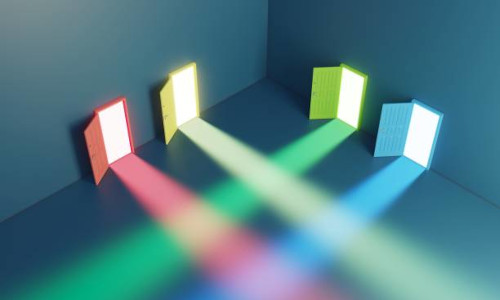
Non-mixités choisies
Les non-mixités choisies sont l’expression d’une réappropriation des luttes sociales : ce sont les opprimé·es qui s’organisent pour elleux et par elleux, sans attendre que les groupes dominants leur laissent une place dans la société. Les non-mixités choisies font échos à la théorie de l’auto-émancipation. Claire Donnet, docteure en sociologie des religions au laboratoire Dynamiques européennes à l’Université de Strasbourg, explique que la théorie de l’auto-émancipation appréhende la non-mixité choisie « comme la condition pour que les expériences de discrimination et d’humiliation puissent se dire sans crainte. Les groupes mixtes de lutte (dominant[e]s/dominé[e]s) auraient tendance à reproduire la vision dominante du préjudice subi par le groupe dominé. » (8)
La théorie de l’auto-émancipation est une théorie politique. Dans les années 1960, ce sont les mouvements américains en lutte mixte pour les droits civils qui ont décidé d’évoluer vers une lutte non-mixte en créant des groupes fermés aux blanc·hes. Cette non-mixité choisie permet aux individus dominés de s’exprimer librement avec colère, tristesse et révolte concernant les oppressions et discriminations qu’iels subissent, sans devoir se justifier. Cette non-mixité est également essentielle dans la lutte pour l’émancipation car elle permet de se détacher de l’emprise des groupes dominants et ainsi, de valoriser le savoir situé : c’est en étant concerné·e que l’on peut analyser pleinement les enjeux d’une situation.
Donna Haraway, biologiste et philosophe féministe, défend l’idée que le savoir est « produit par des sujets qui sont construits par leurs conditions de vie, par leur rapport aux normes sociales, par l’époque historique dans laquelle illes vivent, etc. Cela remet en cause l’idée qu’un savoir neutre, objectif et universel est possible. » (9)
La non-mixité choisie, en plus d’offrir un lieu sécurisant pour les personnes, a également une dimension politique puisque les pratiquant·es refusent l’ordre établi et « ces expériences restent une pratique et une action politiques d’exception qui sont autant de brèches dans l’ordre de la domination[...] » (10).
La pratique de la non-mixité permet alors aux personnes de se sentir en sécurité dans un environnement qui n’est pas hostile. Elle libère la parole et développe l’auto-émancipation, par les personnes opprimées pour les personnes opprimées. Cette non-mixité s’exprime de différentes façons, en fonction des caractéristiques de chacun·e, mais également en fonction de l’histoire. En effet, les femmes expérimentent le sexisme différemment, de manière peu ou prou traumatisante et violente. D’ailleurs, « l’oppression des femmes ne connaît aucune frontière ethnique ou raciale, c’est vrai, mais cela ne signifie absolument pas qu’elle est identique au sein de ces différences » (11). C’est pourquoi, avoir la possibilité de parler de son vécu est important. Mais pour cela, il faut pouvoir se sentir libre de ses mots. C’est aussi le cas pour les personnes qui souhaitent s’exprimer à propos de leur expérience du racisme, du handicap ou des oppressions subies concernant les préférences sexuelles et l’identité de genre, notamment.
Il est également nécessaire pour les personnes exclues de prendre conscience de cette exclusion. Car c’est en ayant pleinement compris sa situation d’opprimé·e dans son ensemble systémique que l’on peut commencer à envisager une lutte pour l’acquisition d’un statut plus égalitaire voire équitable. Et pour ce faire, il est essentiel que les personnes issues des groupes dominants comprennent que leur exclusion dans certains milieux militants ne se fait pas contre elles mais bien pour les personnes victimes des oppressions. Ainsi, la non-mixité choisie ne se met pas en place contre –
les dominant-es – mais pour – les opprimé-es.
Les relations et interactions humaines sont la plupart du temps des échanges en 50– 50, les personnes qui excluent sont responsables de leur acte et de leurs mots et doivent comprendre les réactions des personnes exclues ; celles-ci sont responsables de leurs manières d’interpréter cela et elles doivent elles aussi comprendre pourquoi elles sont exclues. Concrètement, cela implique l’obligation pour les hommes d’entendre et de comprendre pourquoi certaines associations, certaines réunions, certaines conférences leur sont fermées.
Comme évoqué précédemment, l’expérience des non-mixités permet aussi l’identification à un groupe pour se sentir soutenu·e, être solidaire avec d’autres personnes, mais aussi exprimer une certaine fierté à pouvoir s’engager dans une cause qui est importante et personnelle. Le concept même d’identité est assez récent. Il a été appliqué pour la première fois à des groupes dans les années 1960 par Erving Goffman, généralement dans le cas de personnes victimes de discrimination. Ce sont les Afro-Américain·es qui se sont approprié·es en premier la notion d’identité appliquée à des groupes, c’est-à-dire « des groupes victimes de discriminations pour lesquels l’affirmation d’une identité était une façon de retourner le « stigmate » qui les différenciait en en faisant un élément de fierté » (12).
Comme le souligne Anne-Marie Thiesse, « c’est quand il se sent menacé qu’un groupe éprouve la nécessité de radicaliser sa différence par rapport aux autres » et la non-mixité est une forme de radicalité puisqu’elle est excluante, encore plus lorsqu’elle est choisie et assumée. Et c’est quand elle est choisie et assumée qu’elle pose question, car dans notre société alimentée par un universalisme total, il n’est pas reconnu que les êtres sont traités différemment puisqu’il est affirmé que nous naissons et demeurons libres et égaux en droits. Pourtant, les faits sont tout autres et si certaines populations passent par la non-mixité choisie, c’est avant tout pour contrer l’exclusion de fait imposée par des habitudes sociales et sociétales basées sur des stéréotypes et des principes racistes, sexistes, homophobes, validistes...
Les non-mixités dans l’Histoire
La non-mixité est-elle un phénomène récent ? Non. Des exemples à travers différentes époques le prouvent.
La non-mixité n’est pas exclusivement féministe, elle s’exprime depuis longtemps loin du militantisme. En effet, comme nous l’avons dit précédemment, la mixité en France est directement associée à l’instruction et aux établissements scolaires et c’est alors la non-mixité qui est préconisée. D’ailleurs, « [l]a Révolution française a […] élaboré un ensemble de principes qui seront appliqués au cours du XIXe siècle. Celui de la séparation des sexes dans l’école comme dans l’éducation en général, bien posé par la Réforme catholique (XVIe, XVIIe siècles) pour des raisons de moralité [...]. (13) » Ainsi, on pense que mélanger les sexes contribuerait à pervertir les jeunes gens et que cela nuirait à la vie (familiale, politique, sociale) des êtres humains.
Par ailleurs, la non-mixité institutionnelle existe toujours en France dans certains établissements scolaires et dans tous les établissements pénitentiaires (bien que depuis l’assouplissement de la loi concernant la mixité en prison de 2009, la prison de Bordeaux permet à des détenu·es femmes et hommes de travailler côte à côte depuis 2015 tant que la tranquillité et la sécurité règnent, puisqu’en prison la mixité est directement associée à un risque pour la sécurité.). Cette non-mixité institutionnelle n’est que rarement interrogée. Les détracteur·ices de la non-mixité s’attardent davantage sur la non-mixité choisie et militante.
Une pratique de la non-mixité comme outil du militantisme est utilisée et revendiquée à « l’international dans les années 1960 par les Afro-Américain·es qui luttent alors pour leurs droits civiques. Le 29 octobre 1966, Stokely Carmichael, tout juste nommé président du Comité de coordination non violent des étudiants (SNCC), s’écrie « Black Power » devant la foule. Ce slogan devient alors le synonyme du combat des personnes noires pour les et par les personnes noires, impliquant ainsi la nécessité de s’organiser entre elleux. Stokely Carmichael exprime d’ailleurs avec détermination le besoin d’agir pour elleux lorsqu’il affirme : « qu’iels le veuillent ou non, nous allons utiliser le mot « Black Power » et les laisser en parler ; mais nous n’allons pas attendre que les Blanc·hes sanctionnent Black Power. » (14). Cette non-mixité n’exclut par les blanc·hes mais les invitent à lutter contre le racisme au sein de la communauté blanche, laissant ainsi la parole aux concerné·es. Le « Black Power » est un slogan d’auto-émancipation, car malgré l’aide de certain·es blanc·hes dans la lutte contre le racisme dans les années 1960, celleux-ci sont inévitablement en situation de domination (la politique de ségrégation raciale est toujours fortement d’actualité à cette époque). D’autres groupes de lutte contre le racisme revendiquent leur non-mixité à l’instar des Blacks Panthers, qui n’ouvrent pas les portes de leur association aux blanc·hes.
Plus tard, dans les années 1970, différents groupes féministes afro-américains décident de s’éloigner et « [e]n 1973, à New York, des féministes afro-américaines jugent nécessaire de former un groupe séparé, qui deviendra la National Black Feminist Organization (NBFO). (15) »
En France, le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) fait également le choix de la non-mixité. Les membres du mouvement l’expliquent dans le numéro de Partisans consacrés à la « Libération des Femmes année zéro » de 1970.
Elles ont pris conscience « qu’à l’image de tous les groupes opprimés, c’était à [elles] de prendre en charge [leur] propre libération. En effet, si désintéressés soient-ils, les hommes ne sont pas directement concernés et retirent objectivement des avantages de leur situation d’oppresseurs. Seule l’opprimée peut analyser et théoriser son oppression, et par conséquent choisir les moyens de la lutte » (16). Avec cette affirmation, les militantes du MLF mettent en avant la théorie de l’auto-émancipation qui se développe déjà aux États-Unis : elles affichent leurs inspirations et montrent que les luttes et causes militantes sont internationales.
Enfin, de nos jours, la non-mixité militante devient légitime et fait sa place. Si la non-mixité choisie est un soulagement dans les milieux en luttes, c’est parce qu’elle garantit une plus grande égalité dans ces groupes, tout en sortant du mythe de l’égalité universaliste. Ainsi, différentes associations et différents collectifs féministes arborent une non-mixité au sein de leur groupe (non-mixité de genre comme l’association Une Chambre à Nous ; non-mixité raciale comme le collectif MWASI ou encore non-mixité religieuse comme l’association Lallab) ou plus ponctuellement avec des réunions en non-mixité comme l’association GARCE par exemple ou encore NUIT DEBOUT. Bien que ce dernier ne soit pas un mouvement féministe, il est pertinent de l’évoquer puisque la mise en place de réunions non-mixtes pour les femmes et minorités n’a pas été une initiative très bien accueillie, surtout par certains hommes participant pourtant à NUIT DEBOUT et étant donc sensibilisés aux différentes formes de discriminations (notamment celles liées au statut socio-économique).
Pourtant, comme évoqué précédemment, la non-mixité, au lieu d’être comprise comme étant nécessaire pour les personnes, est encore critiquée et rejetée, car considérée comme discriminante.
Pour conclure, si la non-mixité choisie se généralise de plus en plus, c’est que la société et notamment les responsables politiques, ont échoué dans l’inclusion de tous les individus constituant sa société. Bien qu’il existe un cadre légal, notamment avec la loi sur la parité, cela n’a pas permis la création d’un consensus social considérant chaque être humain de façon égalitaire. Ainsi, lorsque les espaces privés et publics sont majoritairement habités par des hommes cis, il est logique que les exclu·es s’organisent ensemble pour créer l’espace qui ne leur est pas accordé au sein de la société.
La pratique de la non-mixité choisie devient alors essentielle si l’on souhaite, un jour, évoluer dans une société véritablement équitable.
ophelie ecceite
(1) Le terme « mixte » vient du latin miscere qui signifie « mélanger ».
(2) Une histoire de la mixité - Les Cahiers pédagogiques, http://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-histoire-de-la-mixite, consulté le 28 avril 2018.
(3) IBID.
(4) IBID.
(5) Lehman-Frisch Sonia, « La ségrégation : une injustice spatiale ? Questions de recherche », Annales de géographie, 2009, no 665‐666, pp. 94‐115.
(6) Haas Caroline de, De l’utilité de la non-mixité dans le militantisme, https://blogs.mediapart.fr/carolinedehaas/blog/210416/de-l-utilite-de-la-non-mixite-dans-le-militantisme
(7) Roncayolo M. (2001), « Mixité sociale et ségrégation : la dimension historique », IAURIF.
(8) Donnet Claire, « Des féminités pieuses et la calcification des normes de genre, Pious Femininities and the Crystallisation of Gender Norms », Cahiers du Genre, 15 décembre 2014, no 57, pp. 183‐201.
(9) Mona Gérardin-Laverge et Anne-Claire Collier, « Circulation et production des savoirs. »
(10) Breaugh Martin, « Que faire du désordre ? », Tumultes, 24 juin 2013, no 40, pp. 163‐179.
(11) Lorde Audre, Sister Outsider, Mamamélis., 2003, 212 p. p76.
(12) Propos d’Anne-Marie Thiesse, historienne et directrice de recherche au CNRS, in Wieder Thomas, « Aux racines de l’identité nationale », Le Monde.fr, 06/11/2009. Disponible à l’adresse : https://www.lemonde.fr/politique/article/2009/11/06/aux-racines-de-l-identitenationale_1263699_823448.html
(13) Pezeu Geneviève, « Une histoire de la mixité », Les Cahiers pédagogiques, no 487.
(14) Citation originale : « [...] whether they like it or not, we gonna use the word “BlackPower” and let them address themselves to that; (applause) but that we are not goin’ to wait for white people to sanction Black Power ».
(15° Dorlin Elsa, « De l’usage épistémologique et politique des catégories de « sexe » et de « race » dans les études sur le genre, The epistemological and political usage of the “sex” and “race” categories in gender studies », Cahiers du Genre , 2005, n o 39, pp. 83 -105.
(16) Jacquemart Alban et Masclet Camille, « Mixités et non-mixités dans les mouvements féministes des années 1968 en France » , Clio, 2017, n o 46, pp. 221 ‐ 247.



