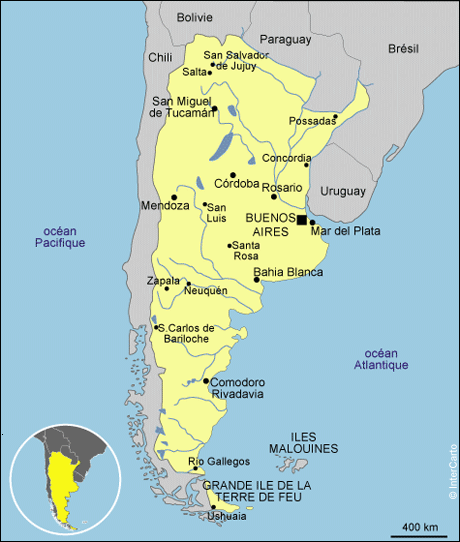L'histoire de l'Argentine est passionnante. Elle n'est pas figée et fait régulièrement l'objet de polémiques, tant les oppositions politiques, ethniques, sociales sont encore fortes.
Pour accompagner la lecture de l'ouvrage d'Alicia Dujovne Ortiz (lire (Ré)acteurs), voici quelques repères, pour comprendre mais aussi pour donner envie d'aller plus loin dans la « visite » de ce pays fascinant.
Repères géographiques
Situation : au sud du continent américain ; partage ses frontières avec le Chili à l'ouest, le Brésil et le Paraguay au nord, le Brésil et l'Uruguay à l'est.
Superficie : 2.780.000 km² (soit cinq fois la France) dont 30.200 km² de côtes. Huitième plus grand pays du monde.
Nombre d'habitants : environ 43 millions d'Argentins et Argentines.
Climat : varié selon les régions ; subtropical au nord, tempéré vers le Rio de la Plata, froid en Patagonie et dans la Terre de Feu.
Point culminant : montagne de Aconcagua à 7.000 mètres.
Géographie : cinq grandes régions naturelles : la Patagonie au sud (grands plateaux), la Pampa à l'est (plaines), les Andes du nord-ouest (champs, montagnes), les Andes Centrales (montagnes), les Plaines du nord-est (marécages, savane, forêts, grands fleuves).
Repères historiques
Avant l'arrivée des Espagnols : territoire peuplé par des tribus indiennes, dont certaines font partie de l'empire inca.
1516 : le navigateur espagnol Juan Diaz de Solis débarque dans la région du Rio de la Plata.
1536 : début de la colonisation par les Espagnols et fondation de la ville de Buenos Aires, aujourd'hui la capitale de l'Argentine (depuis 1826). Début de la persécution des peuples indiens, qui ne cessera jamais tout à fait.
1806 et 1807 : les Espagnols repoussent des expéditions militaires anglaises qui tentent de s'approprier le territoire.
1810 : renversement du vice-roi.
1816 : le congrès de Tucuman proclame l'indépendance.
1829 : le général Juan Manuel de Rosas unit les différentes provinces. L'ensemble est baptisé « Confédération argentine ». Il favorise l'arrivée de millions d'immigrants, notamment des Italiens, pour développer l'économie.
1853 : adoption d'une constitution (révisée en 1860, 1866, 1898, 1957, 1994).
Fin du XIXe siècle : affirmation du libéralisme économique ; enrichissement des grands propriétaires terriens et des exportateurs ; opposition des classes moyennes et populaires (radicalisme).
1916 : mise en place de réformes sociales par le président Hipolito Yrigoyen.
À partir de 1929 : Argentine touchée par la Grande Dépression. Succession de coups d'État organisés par les militaires et les conservateurs.
1943 : coup d'État par un groupe d'officiers nationalistes dont Juan Domingo Perón. Avec sa femme Eva, instaure un régime populiste dit « justicialiste ».
1955 : coup d'État contre Peron toutefois réélu en 1973. À sa mort en 1974, sa troisième femme Isabel prend le pouvoir.
1976 –1983 : dictature militaire marquée par les disparitions, les internements arbitraires, la torture… (officiellement, 30.000 morts et disparus).
1982 : guerre des Malouines contre le Royaume-Uni. L'Argentine veut récupérer les îles Falkland situées au large de sa côte sud est. Trois mois plus tard, victoire du Royaume-Uni.
1983 : retour des civils au pouvoir avec le président radical Raul Alfonsin. Graves problèmes économiques.
1989 : élection du péroniste Carlos Saul Menem à la présidence (réélu en 1995).
1991 : création du Mercosur, le marché commun du sud, avec le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.
1991-1996 : pour juguler l'hyper-inflation, le peso argentin est lié au dollar américain, ce qui provoque le ralentissement de l'économie et l'augmentation du chômage.
2000 : plan de soutien du Fonds Monétaire International (FMI).
2001 : grave crise économique ; pillages, émeutes...
2003 : élection de Nestor Kirchner. Le « kirchnerisme » est marqué par un fort interventionisme de l'État, notamment dans le domaine économique, et la redistribution de la manne agricole.
Accord avec le FMI pour reporter le remboursement de la dette du pays.
2005 : remboursement anticipé de la dette de 9,8 milliards de dollars auprès du FMI.
2007 : création, avec cinq autres pays sud américains, d'une Banque du sud pour améliorer l'autonomie financière des participants, et contourner le FMI et la Banque mondiale.
2007 : élection de Cristina Kirchner à la succession de son mari. Plan anti-crise avec mesures de soutien aux entreprises et investissements publics. Augmentation des taxes à l'exportation qui provoque la colère des agriculteurs.
2010 : autorisation du mariage homosexuel (l'Argentine est le premier pays sud américain à l'autoriser). En revanche, l'avortement est toujours interdit.
2011 : réélection de Cristina Kirchner.
Depuis 2015 : présidence de Mauricio Macri, de centre droit. Mesures pour redresser l'économie mais inflation toujours élevée.
L'Argentine assurera la présidence du G20 en 2018.
Repères institutionnels
Régime actuel : république fédérale, régime présidentiel.
 Pouvoir exécutif : élection du président pour quatre ans au suffrage universel direct.
Pouvoir exécutif : élection du président pour quatre ans au suffrage universel direct.
Pouvoir législatif : le Congrès bicaméral est composé d'une Chambre des députés de 257 membres, renouvelée par moitié tous les deux ans, et d’un Sénat, renouvelé par tiers tous les deux ans, de 72 membres élus dans chaque province (trois sièges dont un réservé au parti arrivé second à l’élection).
Système fédéral : 23 provinces et la capitale fédérale Buenos Aires dirigées par un exécutif élu pour quatre ans au suffrage universel direct (le gouverneur et le vice-gouverneur) et des assemblées régionales.
Principaux partis :
- Propuesta Republicana : coalition de partis de centre droit ; dirigée par Mauricio Macri, ancien maire de Buenos Aires et président élu en 2015.
- Mouvement National Justicialiste, ou Péroniste : principal mouvement de masse argentin, créé autour de Juan Perón en 1946 ; regroupe plusieurs tendances allant de la droite conservatrice à la gauche ; a perdu les élections présidentielles en novembre 2015, mais toujours une importante représentation au Sénat et à la Chambre des députés.
- Parti Radical, ou Union Civique Radicale : parti centriste ; regroupe des libéraux centristes et des sociaux-démocrates ; s’est allié avec le parti de Mauricio Macri au sein de Cambiemos.
Langue officielle : espagnole
Monnaie : peso
Pourquoi le pape évite son pays natal ?
Le lundi 15 janvier 2018, le pape François entamait une nouvelle tournée en Amérique du Sud.
La sixième depuis son élection de chef de l'Église catholique, en mars 2013.
Une fois de plus, il ne s'est pas rendu en Argentine, qui est pourtant son pays natal, mais au Chili et au Pérou. Lors de ses précédents voyages, ce sont le Brésil, l'Équateur, la Bolivie, le Paraguay, Cuba, le Mexique et la Colombie qui avaient été choisis.
Alors, pourquoi pas l'Argentine ? Les observateurs pensent qu'il ne souhaite pas être utilisé par le pouvoir en place, celui du président de centre droit Mauricio Macri. Les prises de position du pape en faveur des pauvres et des persécutés du monde entier, donnent des arguments à ceux qui l'accusent de péronisme et donc, d'opposant à Macri.
Son voyage en Amérique du Sud a été marqué par le soutien aux Indiens, notamment les Mapuches (persécutés en Argentine), aux immigrés Haïtiens au Chili, ainsi qu'aux populations d'Amazonie au Pérou./20180115-pourquoi-pape-francois-va-pas-argentine