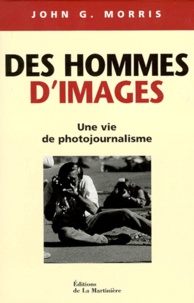Beaucoup moins célèbre que ses amis Robert Capa, « Chim » ou Henri Cartier-Bresson, John G. Morris est pourtant une figure incontournable du journalisme et, plus particulièrement, du photojournalisme. Son livre est celui d'un passionné et d'un véritable passeur.
John Godfrey Morris est né en 1916 aux Etats-Unis et il est décédé cent ans plus tard à Paris. Durant toute sa vie, il a observé l'évolution de la presse écrite, et y a contribué activement, notamment par la photographie. Dans son livre autobiographique, « Des hommes d'images - Une vie de photojournalisme » (éditions de La Martinière), il raconte comment l'image est entrée progressivement dans les foyers, pour informer, éduquer, choquer, provoquer, révéler… et pas seulement illustrer. Pour John G. Morris, la vocation du photojournalisme est de « poser sur le monde un regard engagé ». Les journalistes ne sont pas neutres et les photo-éditeurs comme lui non plus.
Durant ses études de sciences-politiques, il créa une revue avec des amis. Une fois diplômé, il commença comme garçon de bureau et gravit progressivement les échelons pour devenir, aux débuts des années 1940, « photo editor » au sein de l'hebdomadaire Life, au bureau de Londres. Son rôle ? Assister les photographes, les envoyer en reportage selon les commandes de la rédaction, puis choisir et mettre en scène leurs images.
C'est ainsi qu'il eut la lourde responsabilité des clichés de Robert Capa pris durant le Débarquement des Alliés en 1944 à Omaha Beach. Capa devint d'ailleurs un véritable ami, tout comme David Seymour alias « Chim », Henri Cartier-Bresson et George Rodger, les fondateurs de l'agence Magnum, qu'il dirigea de 1953 à 1961. De Life au National Geographic en passant par le Ladies' Home Journal, le Washington Post et le New York Times, la carrière de John G. Morris est liée aux grands événements du XXe siècle et aux grands noms qui font désormais l'histoire du journalisme : W. Eugene Smith, Myron Davis, George Silk, Elliott Erwitt, James Nachtwey, Lee Miller…
Chaque fois que je repense à ce livre passionnant et que je regarde la couverture représentant l'un des plus talentueux et engagés photojournalistes, James Nachtwey, je repense à l'une de ses « anecdotes ». Un jour de novembre 1998, alors qu'il se trouvait à Djakarta et prenait des photos d'un Chrétien poursuivi par une foule, il s'interposa pour éviter le lynchage. Un de ses confrères de l'agence Reuters raconta plus tard que James Nachtwey supplia la foule pendant près de vingt minutes à genoux. En vain. Mais il jura de continuer : le journaliste simple témoin de son époque, trop peu pour lui. « Si tout se passe dans l'ombre, tout peut arriver. Il faut regarder la réalité en face. Il faut faire quelque chose, sinon qui le fera ? » (1)
C'est cet esprit de combat et cette éthique que John G. Morris raconte. Passionnant, son livre est d'autant plus précieux aujourd'hui, que l'on vit une époque où chacun.e peut se prétendre journaliste et photographe, confondant le rôle de témoin et celui de messager.
(1) « James Nachtwey, photographe de l'antiguerre » par Armelle Canitrot, journal La Croix daté du 18 novembre 2002 : https://www.la-croix.com/Archives/2002-11-18/James-Nachtwey-photographe-de-l-anti-guerre-_NP_-2002-11-18-170051